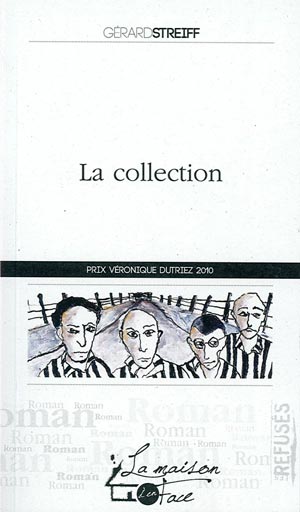La collection
Gérard Streiff
« Tout a déjà été dit, mais comme personne n’écoute, il faut toujours recommencer »
André Gide
Résumé
4 de couverture
Week-end noir en Alsace. Un fois l’an, des anciens de 1968 ont rendez-vous du côté de Strasbourg, pour une séquence nostalgie. Cette année, il y a là un flic dont l’enquête patine ; un cinéaste qui lutte contre l’omerta locale ; un toubib qui a viré humanitaire ; et une trentenaire, une journaliste parisienne. Tous se retrouvent au « Jérusalem », le dernier café d’un village à la casse, hanté par d’étranges randonneurs.
Etait-ce une si bonne idée de se réunir là ? A croire que leur rencontre réveille les démons et ravive les souvenirs, du temps où la SS dirigeait l’université alsacienne et voulait y créer un musée pas tout à fait comme les autres.
1
Vendredi 13 mai
16h
Une odeur aigrelette emplit l’appartement. Le capitaine Cesare Boreli a l’impression de pénétrer dans un laboratoire de la « Crim ». Il y a dans l’air un remugle entêtant sur lequel il n’arrive pas à mettre un nom. A première vue, tout est vieux ici, les fauteuils avachis, les tapis élimés, les étagères bancales, les livres lustrés, les boiseries patinées, les luminaires rococos. Le lieu baigne dans un ton ocre brun ou plus exactement caramel.
Le flic s’arrête, fait craquer ses doigts, l’un après l’autre ; il commence par la main gauche, il fait ça méthodiquement. C’est une manie chez lui. Chaque fois qu’il est en face d’un problème, un gros, il se désarticule méticuleusement les phalanges ; on dirait qu’il remonte sa machine interne, son boîtier personnel.
Mme Wenger, la concierge, une femme replète et remuante, le regarde faire avec une mine pincée. Elle l’attend. Sa gymnastique manuelle terminée, il colle au train de la bignole. Elle en tremble d’excitation.
Un long et large couloir, mansardé, fait office de salon. Sur la droite, trois fenêtres de forme ovale donnent sur un ciel gris-bleu où paressent de gigantesques cumulus. Boreli trouve que l’un d’eux ressemble à sa chatte, Zoé, un animal tout en longueur.
De l’autre côté du corridor, une succession de portes sont grandes ouvertes. La grosse femme bredouille :
– Ça fait une semaine qu’on n’avait plus vu le docteur.
Une pause. Elle semble économiser ses informations.
– Enfin, on dit le docteur Kougelman, Ernest Kougelman, mais on sait même pas s’il l’était vraiment, docteur.
– Vous voulez dire ?
– Il n’a jamais été foutu de me donner le moindre conseil. Ce qui est sûr, c’est qu’il a passé sa vie à travailler à l’Hôpital. Même après sa retraite, il continuait de s’y rendre. Il n’a renoncé à cette habitude que ces derniers temps. Parce qu’il avait du mal à arquer. Pensez, avec l’âge !
– Ça lui faisait combien ?
– C’est bien simple, il a fêté ses quatre vingt cinq ans au début de cette année.
Ce relent... Ce doit être un désinfectant, rumine le capitaine qui s’entend questionner, machinal :
– Il avait de la famille ?
– Je crois pas, je lui ai jamais vu de visites !
– Il sortait ?
– Tous les jours. Il allait du côté de la Petite France. D’ordinaire, il venait taper à ma porte avant sa balade.
– Donc vous l’avez plus vu depuis une semaine.
– C’est exact.
– Et vous ne vous êtes pas inquiétée de ne plus le voir ?
– Ben…
– Huit jours, c’est long tout de même !
– C’est la faute au pont !
Le 8 mai tombait un mercredi, elle en avait profité pour prendre quelques jours, aller voir ses enfants, du côté de Schirmeck.
– Ça s’est pas bien passé d’ailleurs…
– Quoi donc ?
– Avec mes gosses ! Des bohèmiens, je vous dis ! Si j’avais su, j’aurais mieux fait de rester ici… Le docteur serait peut être encore là. Et puis l’ambiance !
– Dans la famille ?
– Non, à Schirmeck ! Avec la profanation du cimetière ! Ils parlaient que de ça, en ville ! Il y avait des horreurs peintes sur les tombes ! Des croix gammées, des trucs nazis…c’était dans la presse. Vous avez pas vu ?
La concierge regarde le flic, étonnée ; il ne lui inspire vraiment pas confiance.
– Bref, je suis rentrée ce matin. J’ai fait le tour de l’immeuble, question d’habitude…Il y avait de l’eau sur le pallier du docteur. Ça sentait drôlement. Je sonne, je sonne, personne. Mais j’ai pris le double des clés et c’est comme ça…
Elle ne termine pas sa phrase.
– Il doit être dans un sale état.
– Qui ?
– Ben, le docteur ! Après une semaine ?!
– Au contraire.
– Comment ça, au contraire ?
– Vous allez voir…
Boreli remarque au mur un crucifix où est fiché du buis séché. L’image fait tilt. Il repense à l’école primaire, il y a un siècle de cela. Les curés ici assurent le catéchisme en classe ; le concordat, comme on dit. La séparation de l’Eglise et de l’Etat, c’est bon pour le reste de la France. Chaque lundi matin, la visite du prêtre était au programme ; on pouvait à la rigueur en être dispensé mais sa mère avait insisté pour qu’il y aille, son père avait laissé faire, comme d’habitude…Quand le directeur reprenait possession des lieux, il se gardait bien de croiser l’ecclésiastique ; simplement, il criait en traversant la salle d’un pas décidé : « Ouvrez les fenêtres, ça sent le corbeau ! ». Ce rituel était immuable.
« Ça sent le corbeau ! ». Le flic répète à haute voix le cri de guerre du vieux dirlo laïquart. Madame Wenger sursaute, le dévisage.
− Le corbeau ?
− Non, rien, faites pas attention.
La première porte sur leur gauche ouvre sur la salle de bains. Un petit néon, au dessus du lavabo, clignote de manière capricieuse et projette par intermittence une lumière crue dans la pièce ; le tube devait être naze. Dans la baignoire, à moitié pleine, tournoie mollement une escouade de poissons rouges.
– C’est quoi ça ?
– Ses poissons.
– Je vois bien.
Le flic s’approche, détaille les bestioles :
– Je peux même vous dire que ce sont des carassins ou des cyprins dorés. Mais qu’est-ce qu’ils foutent là ?
– Justement…
Elle n’en dit pas plus. Mais il sent la grosse femme de plus en plus agitée.
– Le pépé se lançait dans la pisciculture ?
Elle se contente de hausser les épaules. Il l’énerve. Il le sent. Il en rajoute.
– Attendez, laissez moi deviner… C’est un croisement de carpes miniatures et de piranhas et ils ont bouffé leur proprio ?
La dame s’émeut.
– Monsieur Baraoui…
– Boreli.
Les poissons cependant ont l’air affamé, son hypothèse n’est pas la bonne. Déjà la concierge est repartie plus avant. Elle est potelée de partout. A chaque mouvement, sa silhouette frissonne, parcourue par une légère onde. Mais il y a comme un petit retard de l’emballage sur le mouvement, comme si son enveloppe dodue avait un peu de mal à suivre le geste. Le flic s’amuse de ce manque de synchronisme. Dame Wenger ressemble à cette femme de ménage du commissariat central, qui a un peu la même corpulence et que tout le monde surnomme, affectueusement, « Flandy ».
Le tapis du couloir est spongieux ; chaque pas provoque un petit bruit indécent de succion. A l’entrée du bureau, la pipelette se fige, muette, et d’un geste théâtral, elle désigne quelque chose de son bras gauche dressé. Arrivé à sa hauteur, Boreli en oublie presque qu’il patauge dans la mélasse, tant le spectacle est médusant. Au centre de la pièce trône un aquarium de dimensions impressionnantes, le genre d’appareils qu’on voit plus volontiers chez les poissonniers des Halles ou dans les restaurants spécialisés, dans l’entrée des « Trois lotus » par exemple, le Chinois de son quartier, que chez un particulier. Une forme molle et blanchâtre s’étale derrière la surface vitrée, immergée. La dame renifle :
– Le docteur !
Sa voix dérape dans les aigus.
Un mouchoir sur le nez, le flic s’approche lentement et fait le tour du réservoir. Appliqué, comme un esthète tournant autour d’une œuvre d’art, il opine doucement du chef. Le pépé, nu comme un ver, ressemble à un vieux bébé qui aurait retrouvé sa position originelle, dans son sarcophage de verre. Le corps est lesté par des haltères au fond de son bocal. Le visage est pressé contre la paroi ; toute sa partie droite est plissée, dans une grimace hideuse, la bouche ouverte, tordue, la langue tirée, pointue, la joue écrasée, le nez se ratatinant, les paupières fermées. En pivotant légèrement, Boreli croise l’autre œil du malheureux, exorbité celui là, qui le regarde avec un effroi définitif.
Le bonhomme a l’air parfaitement conservé.
Il règne dans la pièce un grand désordre ; tout l’attirail de l’aquarium, pierres, gravier, vrai corail et fausses plantes, est éparpillé au sol, lui-même encombré de bonbonnes. Le flic a du mal à échapper à la fascination de ce mort. Quand il revient dans le couloir, la concierge, effondrée, psalmodie devant une fenêtre à demi ouverte : « Pauvre docteur ! Le pauvre docteur ! ».
La vue plonge sur les berges de l’Ill et le carrefour de la Gallia, une brasserie d’étudiants. Sur le quai d’en face, on devine le fantôme d’une inscription sauvage des années soixante. Malgré des badigeonnages successifs pour camoufler le propos, la queue du slogan reste encore lisible : « … périr d’ennui ». Chaque fois qu’il croise ce mur, le capitaine se remémore toute la phrase : « Nous ne voulons pas d’un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s’échange contre la certitude de périr d’ennui ». On n’avait pas peur de faire long à l’époque.
Selon un rituel matinal bien réglé, la rue s’active. Toute une humanité s’agite ferme ; les gens, comme dans un film en accéléré, s’affairent, traversent, trottinent, descendent des bus ou y montent ; tous sont en route pour le chagrin. Seuls à échapper à la fébrilité ambiante, des fantômes errent, devant un café kurde et un petit square, à droite. Le quartier est devenu le nouveau lieu de rendez vous des exilés orientaux, en partance pour Paris puis Londres. Une rangée d’arbres au feuillage vert foncé, en face du bistrot, portent, sur leurs plus hautes branches, de gros fruits ronds, insolites et multicolores ; ce sont les sacs de couchage que les migrants cachent dans la journée, à l’abri des prédateurs. La concierge suit son regard et bougonne. Il croit lire sur ses lèvres : « Des bougnoules ! ».
Il se souvient du regard qu’elle lui a jeté quand il s’est présenté tout à l’heure :
« Capitaine Boreli ».
Elle lui a lancé, sans réfléchir :
– Excusez moi mais j’attends la police !
– Je suis la police, madame.
Elle a vraiment eu l’air de trouver ça scandaleux mais elle marqua une pause avant de faire de nouveaux commentaires. Elle avait dû lui trouver un type sudiste trop prononcé avec ses cheveux ondulés, son teint mat, son nez trop grand, ses lèvres gourmandes. C’est vrai qu’il est roux : ça complique un peu l’identification. Et ça le sauve. Un italien roux, ça court pas les rues.
Le flic s’ébouriffe machinalement la tignasse. Combien de fois on lui a dit que le roux, jadis, c’était l’impur, le foyer sous la terre, les flammes de l’enfer ; c’était la couleur du dieu égyptien de la concupiscence. Le roux, c’est toujours la chaleur d’en bas, celle de la luxure, du désir. Le désir…
Madame Wenger l’avait alors dévisagé, les yeux ronds, et semblait ruminer : « Ça doit être comme ça partout maintenant, même dans la police. Surtout chez les Français de l’intérieur ! ». Elle n’avait pu s’empêcher de lui demander :
« Et vous êtes seul ?
– Mes collègues arrivent. Le parquet, le médecin légiste, l’ambulance. Ça va comme ça ? Vous voilà rassurée ?
– Oh moi, je disais ça comme ça !
– On peut visiter ?
Tout en regardant la ville s’animer, le flic se dit qu’on a noyé le pépé dans un bain de formol. Il demande :
« Vous savez ce que c’est, du formol ?
– C’est pas pour soigner la douleur ?
– Non, ça, c’est du synthol ! Du formol, c’est une solution de formaldéhyde ou aldéhyde formique, un gaz incolore, du HCHO si vous voulez, utilisée pour conserver les organes.
– Il y en a qui aime se compliquer la vie, tout de même.
Il ne sait pas si la vieille parle de la formule chimique ou de l’organisation du crime ; il opte pour la seconde hypothèse.
– Je vous le fais pas dire. Imaginez le bazar. Le zigoto, enfin je veux dire : le tueur, mais peut-être étaient-ils plusieurs, a dû vider l’aquarium pour le remplir de formol, et y plonger enfin le vieux.
– Sacré boulot, ponctue l’autre, soudain presque admirative.
– Il a dû y passer des heures à monter son opération ; c’est pas croyable que personne ne l’ait entendu !
– Je vous dis, c’était le pont.
– Le pont, oui. Il tombait bien, celui-là
– C’est bien simple, il y avait pas un chat dans l’immeuble ; dans le quartier non plus d’ailleurs. Sauf les touristes. Et puis les autres là, fait-elle, avec un mouvement de menton teigneux vers les Kurdes.
– Et je vous parle pas des va et vient dans les escaliers pour monter les bonbonnes.
Les dames-jeannes éparpillées dans le bureau font au moins dix litres chacune. La bignole s’étonne :
– Il en faut combien pour remplir l’aquarium ?
– Bonne question ! Je ferai plancher mes stagiaires là dessus.
– Comment vous pouvez blaguer avec ces choses ?
– Si on blaguait pas de temps en temps... Surtout dans nos métiers !
– Remarquez, il a sauvé les poissons.
– Ça, c’est vrai, Mme Wenger, mais c’est pas sûr que ça lui donne les circonstances atténuantes, même avec un juge écolo.
Aux pieds de l’immeuble, la voiture du médecin légiste et une ambulance viennent de se garer. Le parquet se fait désirer. Le flic se demande si le docteur était encore vivant quand l’autre a mis tout ce bordel dans son appartement. Est-ce qu’il a tout vu, l’ancien ? Est-ce qu’il a compris, surtout, quelle genre d’exécution on lui réservait ? Quel message on lui adressait ? Car si on a organisé un tel cinéma, c’est bien qu’on voulait lui dire quelque chose. Son « invité » a très bien pu l’immobiliser, le bâillonner, l’installer sur un siège, comme au spectacle. A voir la tête du papy, le capitaine a tendance à le croire. S’il n’a pas fait une attaque avant, le toubib a assisté à la mise en scène de sa mort. L’autopsie devrait le dire.
La concierge demande soudain si une secte ne serait pas derrière tout ça mais le capitaine ne l’écoute pas. Il imagine déjà Pfimlin, son chef, le tancer :
« Alors, Boreli, votre tueur de mandarins est de retour, on dirait ? Va falloir ressortir vos dossiers, mon vieux. Et les archives ? Vous avez des nouvelles des archives ? Bougez vous un peu, cette fois, OK ? »
2
STRASBOURG, été 1945
Noir
Mon commandant, Belzébuth, le seigneur du fumier, existe, je l’ai rencontré. Enfin, j’ai déniché son antre. Il se trouve dans la chambre 11 des caves de l’Institut d’anatomie de la faculté de médecine de Strasbourg…
Comme vous le savez, je suis arrivé dans cette ville à la mi décembre 1944. J’étais chargé de mener l’enquête sur les crimes de l’Institut, précisément. Notre service, à Paris, venait d’être alerté par le secteur cinématographique des armées, j’y reviendrai.
J’ai mené, ces derniers mois, des recherches, conduit les interrogatoires à l’hôpital civil, à l’Université, sollicité l’aide de médecins légistes, de toxicologues, d’histologues ; j’ai rencontré à plusieurs reprises des témoins directs du crime, une dizaine de personnes. Les coupables sont identifiés mais tous, ou presque, sont en fuite.
J’ai consigné cette descente aux enfers dans ce journal de bord ; il vous est destiné, mon commandant, en qualité de juge d’instruction près le tribunal militaire de la Xème région de Strasbourg.
Il m’a semblé que le plus simple était de raconter les choses dans l’ordre chronologique où elles se sont déroulées.
Avant toutes choses, je vous prie de bien vouloir excuser mon style. C’est mon premier rapport, l’ai-je dit ? Il ne présente certainement pas la rigueur juridique voulue. J’avoue que je n’ai guère fait de droit. Plus exactement, mon commandant, je n’ai jamais fait de droit, ni aucune autre discipline d’ailleurs. Avant guerre, j’étais …peintre. Je louais un atelier, avec deux collègues, à la Ruche, cette cité d’artistes rue de Dantzig, à Montparnasse. Heureusement, je pouvais compter sur ma compagne pour manger ; et encore, je dirais qu’on ne mangeait pas tous les jours à notre faim ; je subsistais tant bien que mal en faisant de la décoration de restaurants, ou de cafés. Il faut dire qu’il y avait une vraie solidarité dans notre groupe de peintres, faméliques mais partageux. Une de nos combines consistait à se faire inviter, les vendredi, dans une brasserie des grands boulevards, pour faire la claque lors de mariages ; il suffisait de venir en costume et de jouer les figurants ; le buffet était à volonté ; ce n’était pas trop dur même si, à la longue, ça devenait lassant. Mais je m’égare, direz vous. Pas tout à fait, en vérité. De notre groupe, le seul à être un peu connu était Francis Grüber, mon ami, mon maître. Son art sombre, fantasque, ses personnages émaciés, ses longues filles maigres, ses corps douloureux me subjuguaient. A croire qu’il prévoyait l’Apocalypse. En fait je crois bien aujourd’hui qu’il pressentait vraiment la guerre, bien mieux en tout cas que tous ces messieurs du Pouvoir et de l’Armée, pardonnez cet irrespect, qui auraient dû nous alerter et qui, eux, n’ont rien vu venir. Ou rien dit. En 1936, j’avais été réformé mais quand le conflit éclata, je fis des pieds et des mains pour partir sur le front ; on m’a pris, finalement, dans l’artillerie ; je ne me suis pas beaucoup battu mais tout de même, je pense avoir sauvé l’honneur. Notre bataillon a résisté tant qu’il a pu, peu, puis s’est replié vers le Sud. Démobilisé, fin 1940, et de retour à Paris, je ne pouvais pas reprendre mon activité de peintre, plus personne alors ne s’intéressait à l’art… et aux artistes. Les temps étaient épouvantables ; et puis je me retrouvais seul, le groupe s’était disloqué, Grüber était introuvable, ma compagne avait disparu ; j’ai finalement trouvé un travail d’enseignant à l’école des arts appliqués. Hôtel de Salé. Et là, la jonction avec la Résistance et les « services » s’est faite d’une manière un peu saugrenue : j’avais coutume, avec mes élèves, pour les travaux pratiques de dessin, de déambuler en ville et j’encourageais ces enfants à faire des croquis in situ ; on tombait assez régulièrement, forcément, sur des bâtiments tenus par l’occupant, des hôtels, des restaurants, des immeubles de bureaux, des postes de défense, des ensembles fortifiés ; mes élèves croquaient ces sites, souvent avec les compliments des Allemands eux mêmes ; au début on a fait ça comme ça, un peu par hasard et puis ce travail s’est systématisé ; mes étudiants ont pris l’habitude de faire des dessins de plus en plus précis, plus en plus « professionnels », quasiment des relevés photographiques, ou topographiques. Vous voyez où je veux en venir. Un de ces dessins, en effet, finit par tomber dans les mains d’amis d’amis et un jour, « on » me fit savoir qu’ « on » appréciait. J’étais ingénu et je ne compris pas sur le moment qui étaient ces admirateurs anonymes. On m’affranchit, on me dit de quels services il s’agissait ; il paraît que nos esquisses donnaient des informations de première main à la Résistance. Elles finirent toutes par emprunter le même chemin ; et lors de l’Insurrection de l’été 44, hasard ou pas, les FFI sont venus installer leur QG pour les quartiers du centre parisien dans les caves de mon école. J’étais aux premières loges lors de ces jours fabuleux ; je participais pleinement à l’aventure et je pris vite du galon. A la Libération, on m’affecta aux services secrets de l’armée, avec le grade de capitaine ; j’étais disponible, j’avais très envie de bouger, de pister le nazi, de le débusquer ; on me fit suivre une formation accélérée au « service de recherche des criminels de guerre ». Et quand je dis accélérée, c’est un euphémisme. J’eus deux semaines, en tout et pour tout, pour me familiariser avec mes nouvelles taches. Mon stage à peine terminé, on me demandait de partir pour Strasbourg, ma première mission donc.
Je rappelle, mon Commandant, que la ville de Strasbourg, durant l’été 1940, comme l’Alsace – Moselle, n’a pas seulement été occupée mais annexée au Reich. Purement et simplement. Elle est redevenue, aux yeux de Berlin, une terre allemande, indûment confisquée par les Français en 1918 et perdue avec le traité de Versailles. Résultat : les habitants n’ont plus eu le droit de parler français ; les livres en cette langue ont été brûlés ; les voies ont été rebaptisées ; même le port du béret a été interdit. Pardon d’énoncer de telles évidences, je sais bien qu’elles ne vous ont pas échappé, mais ces aspects sont importants, ils permettent aussi, je crois, de mieux comprendre notre affaire.
Les nazis ont pris possession de l’Université de Strasbourg ; elle a été rebaptisée Reichsuniversität, autrement dit Université impériale. De plus, elle a été placée sous le contrôle de la SchutzStaffel, l’échelon de protection comme ils disaient, la S.S.!
L’Université française avait décampé depuis quelque temps déjà. Un an auparavant, durant la « drôle de guerre », en novembre 1939 exactement, l’administration avait été déménagée en catastrophe à Clermont-Ferrand. On y avait même transféré la brasserie emblématique des étudiants, la Gallia, avec ses clients les plus assidus, les plus germanophobes aussi.
Mais une partie du personnel strasbourgeois était restée en place. Par dépit, par fatalisme ou par conviction. Ces employés vont se voir germanisés et encadrés par la police militarisée du parti nazi.
En 1941 arrive à la direction de l’Institut d’anatomie de la Faculté de médecine August Hirt. Le personnage clé de toute cette histoire. Il y professe l’anatomie, bien évidemment. L’homme a soixante ans. D’après les quelques photos retrouvées de lui, il présente une tête puissante, dure, carrée, pour tout dire. Des mâchoires solides lui donnent un bas de visage presque prognathe ; il a de larges oreilles, légèrement décollées, de petits yeux durs, des cheveux noirs plaqués, séparés par une raie à gauche bien droite.
D’origine suisse, le personnage est connu, et reconnu. C’est un médecin ambitieux, brillant, spécialisé dans la recherche sur le système nerveux sympathique et les tissus vivants. Il est même l’auteur d’une petite prouesse, dit-on, puisqu’il a découvert une technique de microscopie sans coloration. C’est un savant donc. Il n’a rien d’un fou ni d’un agité. J’insiste : c’est un homme raisonnable, intelligent, sensible aussi. J’ai pu apprendre par exemple qu’il était un grand amateur de Richard Strauss, de ses opéras et de ses lieder.
Cependant August Hirt est aussi un nazi notoire. Il est membre de la SS où il a le grade de Hauptsturmführer, rang équivalent à celui de capitaine. C’est donc un membre éminent de « l’ordre noir », comme il aime le répéter.
C’est fascinant de constater combien ces gens se revendiquent de la couleur noire, couleur de la mort, du deuil absolu, couleur du mal. Savez-vous, mon commandant, ce qu’en dit Kandinsky : « Comme un rien sans possibilités, comme un rien mort après la mort du soleil, comme un silence éternel, sans avenir, sans l’espérance même d’un avenir, résonne intérieurement le noir ». Voilà bien ce qu’incarnent August Hirt et ses uniformes noirs : la mort du soleil, de l’espérance.
Il est également un personnage influent d’un organisme intitulé l’« Ahnenerbe ». Littéralement, cela veut dire « études des caractéristiques héréditaires ». Mais cette société savante SS est plutôt connue sous l’appellation « L’héritage des ancêtres ». Une telle association de mots, « société savante SS », peut paraître étrange mais la nébuleuse noire contrôlait toutes les sphères de la vie publique. On peut même dire qu’elle était particulièrement à l’aise dans ces couches privilégiées de la société.
« L’héritage » avait été créé en 1933 pour appuyer la doctrine raciste d’Adolf Hitler, installer l’idée de supériorité aryenne et, dans un même mouvement, confirmer « scientifiquement » l’existence de races inférieures.
Durant la guerre, elle a été rattachée directement aux services de Heinrich Himmler, le numéro 2 du régime.
Au cours de toutes ces années, l’organisation a multiplié les études, les livres, les colloques et autres initiatives publiques pour justifier et magnifier la « race nordique indo-germanique ». Et discréditer, rabaisser, avilir toutes ces « sous-races » : juifs, russes, tziganes, judéo-bolchéviks, noirs, etc, ces « untermenschen », ces sous-hommes, concept dont le « Führer » avait eu « la géniale intuition », répétaient ses épigones. De la même manière étaient visés tous les « anormaux », malades mentaux, épileptiques, tarés, … tous ceux qui faisaient tache.
Le directeur exécutif de cette officine était le Standartenführer SS, colonel donc, Wolfram Sievers, dont August Hirt était un intime.
Autant dire que ce dernier, en 1941, lorsqu’il prend ses fonctions à la faculté de médecine, est un homme puissant, à qui toutes les portes de la société hitlérienne sont ouvertes.
Les premières semaines, à Strasbourg, j’étais très étonné, le mot est faible, choqué, indigné, révulsé par cette idée qu’on ait pu être toubib et nazi. J’étais ingénu et la vie m’a vite déniaisé. Non seulement il n’y avait pas de contradiction entre ces termes mais tout ce que j’ai appris ici montre que le corps médical allemand a été la profession qui a adhéré le plus massivement à l’idéologie national-socialiste. Et à mon avis, on ne sait pas encore tout ! J’ai pu vérifier qu’il ne s’agissait pas seulement, de la part de ces professionnels, d’un accord politique avec les nazis sur le rôle et la place de l’Allemagne mais d’une acceptation idéologique, forte, assumée, du thème hitlérien de la race. Un accord au niveau des idées mais la mise en pratique a suivi : ces gens ont mis la main à la pâte, passez moi l’expression. Sur les quais d’accueil des camps, sur ces rampes où des centaines de milliers de déportés, hébétés, ont échoué, c’était aussi des médecins qui attendaient et triaient ces malheureux.
Au cours de l’avance alliée, ces derniers mois, à l’Est, à l’Ouest, on a pu découvrir que de nombreux toubibs opéraient dans les camps de concentration ou d’extermination ; ils se sont livrés à des expériences épouvantables sur des êtres humains ; on a parlé d’expériences « anatomiques », si j’ose utiliser ce terme, des tests très ciblés en fait, au profit de la machine de guerre nazie : on éprouvait là le plus souvent l’efficacité d’armes nouvelles. Nos services collectionnent actuellement des éléments d’information sur ces horreurs ; les bourreaux auront bientôt à rendre des comptes.
C’est très exactement ce qui s’est passé à l’Université de Strasbourg. August Hirt et les siens ont utilisé l’Institut d’anatomie pour justifier la doctrine raciste de Berlin. Et pour leurs « travaux », ils ont eu sous la main un vivier : l’existence, à une soixantaine de kilomètres de la capitale alsacienne, du camp de Natzwiller-Struthof, le seul camp de concentration nazi sur le territoire français. Ce camp a été découvert, déserté, en novembre dernier par l’armée américaine. Il est installé au beau milieu des Vosges, à 750 mètres d’altitude, paradoxalement dans un cadre splendide. Avant guerre, le Struthof était une station de ski à la mode pour les strasbourgeois, le lieu idéal pour prendre un « grand bol d’air » comme affirmait alors une réclame.
Je l’ai naturellement visité : à flanc de montagne, le site ouvre sur un panorama dégagé ; la vue porte, de l’autre côté de la vallée, sur le Donon et les sommets environnants.
En 1941, les détenus eux mêmes vont construire ce « konzentrationslager ». Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un camp d’extermination bien qu’il comporte une chambre à gaz et un four crématoire, je m’en expliquerai. Mais le régime y était d’une telle sévérité, d’une telle sauvagerie devrait-on dire, que ce camp semble avoir été le plus meurtrier de tout le système concentrationnaire, avec un taux de mortalité record ; 52000 prisonniers y sont passés, 21000 y sont morts.
La plupart ont été tués par la surexploitation, le travail, le froid, la faim, les coups…
Les morts étaient brûlés dans un four crématoire. Ingénieux et méthodiques, les organisateurs du site utilisaient la chaleur de ce foyer pour alimenter une citerne ; celle-ci approvisionnait les SS en eau chaude, en douches, alors que les baraques des prisonniers étaient glaciales, surtout dans cette région où l’hiver peut être sibérien.
L’universitaire August Hirt a donc eu recours pour ses expériences à ces prisonniers, ces « stucks », ces « morceaux » comme il disait. Des morceaux... Jusque là, si mes informations sont exactes, on reste dans la « normalité » de la terreur nazie, passez moi l’expression, mon commandant. Mais en 1942, à un moment où ces fascistes se croient installés au pouvoir pour mille ans, et alors que la germanisation de l’Alsace s’accentue ( les jeunes de la région sont enrôlés de force dans la Wehrmacht ou la Waffen-SS), August Hirt a une idée démoniaque. Soufflée par Belzébuth, j’en suis sûr. Il l’explicite dans une longue correspondance à son ami, le colonel Sievers ; lui-même en informera un proche d’Himmler, qui s’empressera de glisser cette proposition dans l’oreille du dignitaire hitlérien. J’ai retrouvé dans les archives du professeur Hirt une copie de cette lettre.
3
Vendredi 13 mai
21h00
« Thomas n’est pas avec vous ?!
Comme accueil, on pouvait faire mieux. Cesare Boreli n’a pas un salamalek pour Véronique Kemper.
La jeune journaliste oublie un instant le malotru. Elle se dit que tous les halls de gare offrent décidément le même spectacle. Les figurants changent mais la mise en scène est identique. Dans ces salles des pas perdus, il y a toujours plusieurs tribus. Celle des pétrifiés, têtes levées, les yeux sur les panneaux ; celle des sprinters qui enjambent et disparaissent du côté des quais ou de la ville ; celle des fouineurs, qui zigzaguent entre les passants, comme s’ils étaient à la recherche d’un rendez vous manqué. Et puis il y a le clan des assis, côté brasserie. Du genre anxieux silencieux toujours en avance ou retardataires bavards, espérant prendre le train suivant. Sans parler des moineaux, tout spécialement effrontés dans ce genre d’endroit.
Devant le kiosque à journaux, elle distingue les « Unes » de la presse locale ; toutes titrent sur une série de nouvelles profanations de sépultures dans la région.
Boreli aurait pu complimenter la jeune fille sur sa tenue – cuir et satin, s’extasier sur sa rousseur – on pourrait les prendre pour frère et soeur ; il aurait pu roucouler, elle n’a rien contre la courtoisie, Véronique. Mais non, l’autre n’en a que pour Thomas…absent !
« Il est pas malade au moins !
– Il n’en n’a plus pour très longtemps, mais il est courageux !
– Non ?!
– Je rigole !
Cesare hausse les épaules… puis se met à rire et s’excuse enfin :
– Pardon, je manque à tous mes devoirs. Soyez la bienvenue à Strasbourg !
Il y a deux semaines de cela, Véronique avait confié à son bibliothécaire préféré, Thomas Singer, que sa revue « Equité » comptait consacrer son numéro de rentrée à 1968 ; la rédac chef trouvait qu’on racontait un peu tout et n’importe quoi sur le sujet et voulait « remettre les pendules à l’heure », rien que ça. Evidemment les cadors de la rédaction s’étaient réservés les meilleurs morceaux du sommaire ; il ne restait à la pauvre pigiste qu’une enquête sur 68 en province ou… rien !
« T’as qu’à prendre Strasbourg, lui proposa Thomas.
1. Parce qu’il y a eu 68 là-bas ?
2. Il y a même eu 68 avant 68 !
3. C’est à dire ?
4. Les situs !
− En Alsace ?
− Affirmatif ! En 1966 !
Les si-tua-tion-nis-tes ! Pour Véronique, le mot rimait vaguement avec Guy
Debord et sa « société du spectacle ». Mais jamais l’idée ne lui serait
venue de l’associer à Strasbourg. Encore moins à cette époque. Or les situs
y avaient défrayé la chronique peu avant 68 : sur le sujet, Thomas était
incollable. C’est vrai qu’il avait fait ses classes universitaires en Alsace.
Mieux : elle apprit qu’il participait à un réseau d’anciens qui se réunissait
une fois l’an pour ruminer leurs souvenirs à l’occasion d’une
« stammtisch ».
5. Mais encore ?
6. Une petite bouffe, à l’alsacienne.
La prochaine messe était imminente, chez l’ami Cesare Boreli. La secte était accueillante. Il invita donc Véronique d’être de la partie ; elle accepta.
7. On se réunit dans un drôle de coin…
8. C’est à dire ?
9. Tu verras.
10. Au moins, c’est clair.
Et voilà qu’au dernier moment, l’autre s’était dégonflé, pour une vague histoire d’inventaire qui urgeait à la BNF. Il était venu en catastrophe, gare de l’Est, annoncer à Véronique que, finalement, il ne descendrait pas. « Tu me représenteras ». Elle hésita mais elle n’avait plus trop le choix. Pour la peine, Thomas était reparti avec Léo en cage. Il aurait la charge du chat pour le week-end.
Là voilà donc, sur le parking, sous un ciel maussade, cheminant à côté de Boreli. Elle le regarde en coin. Véronique sait qu’il est flic, mais Thomas n’a guère eu le temps de lui présenter le bonhomme
« On en a pour une petite heure, dit ce dernier, en invitant la jeune femme à monter dans sa voiture.
A peine installée, elle attaque :
– Alors, policier ?
Il se contente d’opiner.
– Soixantuitard et policier ?
Un demi sourire aux lèvres, il redouble ses hochements de tête, jouant les conducteurs affairés. Ils sortent de la ville.
– Policier intello, si j’ai bien compris.
– Vous êtes toujours comme ça ?
– Comme quoi ?
– Agressive.
– Non, directe. J’aime savoir. Thomas m’a dit que vous étiez l’auteur d’un manuel sur l’enquête criminelle.
– Il y a longtemps.
– C’était, paraît-il, le livre de chevet des élèves des écoles de police. Vrai ?
– C’est exagéré.
– On disait « Le Boreli », comme on parlait, au bahut, du Lagarde et Michard. Toujours selon Thomas.
– Arrêtez de me charrier. Mon pensum a servi pour quelques cours, et puis on l’a oublié. Pour l’heure, je suis plutôt un flic en panne.
La Nationale est saturée. Une procession interminable de camions monopolise la voie de droite. Certains « gros culs » s’amusent même à se doubler. Leurs acrobaties poussives tétanisent les automobilistes. « N’empêche, vous savez, dit-il en se prenant à retardement au jeu, la reine des enquêtes, c’est la criminelle,.
– Non.
– Quoi non ?
– Je ne savais pas.
– On a un point commun, vous et nous. Vous êtes bien journaliste ?
– On peut le dire.
– Alors on fait un métier où il faut aimer écrire.
– J’avais pas vu les choses sous cet angle mais si vous le dites…
– Vous ne me croyez pas mais dans la crime, on passe un temps fou à écrire… On est un peu les greffiers de la mort.
Il semble content de sa formule ; il la répète :
– Oui, les greffiers de la mort ; et il s’agit pas d’écrire n’importe comment, il y a des règles, une méthode.
Il commence à l’amuser ; elle l’encourage.
– Par exemple ?
– Hé bien, vous arrivez sur les lieux du crime, un appart, n’importe où, un type est à terre, un couteau entre les épaules, vous mettriez quoi dans votre rapport ?
– Moi ?
– Oui, imaginez que vous êtes flic.
– Que…cet homme est mort ?!
– Vous allez trop vite. De la méthode ! Il faut aller du général au particulier, ok ?
– ?!
– Vous commencez par décrire le coin. L’adresse, la date. Ok ? Vous… tu…, on se tutoie ?
– Bien.
– Bon, c’est pas pour toi que tu écris, ni pour le public. Le flic ne doit pas se prendre pour un romancier ; tu as un lecteur, un seul, le magistrat ; et l’autre, il a trente dossiers à se taper dans la matinée, ou à l’heure, les grands jours ! Alors il faut qu’en quelques lignes, il arrive à situer le décor de ton histoire, ok ?
Un début de brouillard commence a effacer le décor sur le bas de la nationale.
– On continue. Tu passes à l’objet du délit. Le corps. On le protège, le corps.
– Comment ?
– En enfilant des gants, par exemple. Te voilà devant le corps. Vas-y, à toi d’écrire maintenant : tu dois présenter la scène. Allons-y alonzo !
Véronique gonfle les joues, soulève les sourcils, hésite.
– C’est pas sorcier. On va s’intéresser à quelle heure il est mort, le gus. Dans les polars, il y a toujours un type pour donner l’heure à la minute près. Mais dans les faits, c’est un peu plus compliqué, c’est même souvent approximatif, ce qu’on peut raconter sur l’heure et le jour, soit dit entre nous. Et puis faut décrire la position du bonhomme, chercher des traces, des indices.
– Des empreintes ?
– Absolument. On mettra de la poudre, sur les objets que la victime, et l’assassin, ont pu tenir. Le problème, c’est que souvent, il y en a trop, des traces. J’ai d’ailleurs eu le cas ce matin même mais passons.
– Des taches ?
– Excellentes, les taches. Ça peut être du sang, va savoir, du vieux sang séché.
– Un cheveu ?!
– Oui, c’est bon ça, le cheveu !
– Pourquoi ?
– Facile à étudier, et ça conduit souvent à son propriétaire. Il faut se dire que l’assassin a forcément laissé une trace.
On dirait que le week-end a jeté tout Strasbourg sur les routes. Ça bouchonne à chaque traversée de village.
– Après ces préliminaires, on fouille. Tout. L’appart, la vie du mort …Il faut toujours partir de la victime. C’est d’elle qu’on va remonter au suspect. Faut trouver son jardin secret, il y en a un, forcément. A un moment, on en saura plus sur lui que toute sa famille réunie, sur ses petites manies, ses cachotteries.
– Ça prend du temps ?
– Ça dépend. Mais plus on connaît la victime, plus vite l’identité de l’auteur du crime arrivera. La « crime », tu sais, c’est le rouleau compresseur quand elle s’y met.
– Carrément ?
– Carrément. Non seulement on écrase tout mais on est lent comme l’engin. Il n’y a pas longtemps, j’ai mis la main sur un type ; l’enquête durait depuis quatorze ans : t’imagines la tête du bonhomme quand il nous a vu arriver. Quatorze ans après ! Il avait refait sa vie, s’était marié, un gosse. Pourtant il a pigé tout de suite quand il m’a vu ; il n’a pas fait de difficulté, il nous a suivi, ça n’a pas traîné.
Véronique reste songeuse. Il la relance :
– Et comment on fait pour trouver une piste ?
– Hé bien …
– On sonde les témoins, on décortique le carnet d’adresses, on fait une enquête de voisinage. On part de l’idée qu’il y a quelqu’un qui a vu quelque chose. Ou une enquête de passage : tu sais que la victime passait par un lieu précis tous les jours à telle heure ; tu te colles à cet endroit, tu interroges, tu demandes aux habitués s’ils n’ont pas remarqué un truc inhabituel.
– Le portrait robot ?
– Bien ! c’est bon ça, le portrait robot pour retrouver un suspect ; mais faut déjà disposer de choses précises. Il y a encore les écoutes téléphoniques, c’est surveillé comme méthode mais bon, on peut essayer.
– Ou les écoutes informatiques ?
– Ou informatiques, exact.
Véronique repère vaguement l’itinéraire. Ils viennent de passer Brumath. Direction Saverne.
– Bon, tu trouves un suspect, tu l’arrêtes, il y a la garde à vue ; ça consiste en quoi ?
Le capitaine ne laisse pas à Véronique le temps de répondre.
– D’abord, oublier l’idée qu’on fait parler les gens à coups de bottins et de projecteurs dans les yeux ; ça, c’est du cinéma ! On n’a jamais rien avec cette méthode, c’est inefficace au possible ; on n’interroge pas par la force. Dis toi qu’on est en face d’un mur et qu’il va falloir le démonter, bout par bout, brique par brique.
– ? !
– Première règle : ne jamais attaquer bille en tête avec le crime ; ça, c’est zéro pointé ; tu prends ton temps, tu as 48 heures devant toi, OK ?
– OK !
– Règle opposée : ne pas oublier le moment venu de poser la question, la bonne question.
– ?!
– Je connais un cas où des collègues cuisinent près de 40 heures un bonhomme ; puis, crevés, ils vont manger une pizza ; une secrétaire assure la permanence, elle demande au gars pourquoi il a tué ; il avoue ; elle lui fait remarquer qu’il n’avait rien dit jusque là. Il lui répond : mais on ne me l’a pas demandé !
La jeune femme éclate de rire.
– Autre règle : faut empêcher le bonhomme de dire non ; c’est un jeu, un jeu psychologique. Je te cite un autre cas qui m’est arrivé : un gaillard garde le silence pendant 46 heures. Motus pendant 46 heures, faut le faire, non ? À la 47e , il avoue mais assure ne rien vouloir signer ; j’étais coincé, j’avais rien d’autre contre lui. Résultat : on n’a pas pu l’embarquer, il est sorti libre une heure après !
– Mais il doit bien y avoir des flics plus doués que d’autres, non ?
– C’est pour moi que tu dis ça ? S’agace Boreli qui tout aussitôt tempère : Remarque, t’as pas tort, je te fais la leçon alors que je suis dans la panade ces derniers temps.
Véronique découvre que son chauffeur, sous ses airs d’ours placide, est un tantinet à cran. L’autre poursuit :
– De toute façon, même pour un flic doué, c’est dur de tenir tous les fils. En fait, c’est le groupe qui mène l’enquête ; on échange, on discute. Faut des gens posés avec toi. Tu sais, les meilleurs enquêteurs sont des gens mariés, avec enfants.
– Ha bon ?
– Oui, les journées sont dures, on a tendance, après, à picoler, si on est seul, trop libre ; on plonge vite. Tu es mariée au moins ?
– Bin, non.
– C’est pas bon, ça. Faut régulariser ?
– Ça va pas non, je postule à rien, moi ?
– C’est ce qu’on dit…
La pluie vient de s’y mettre. Le flic grommelle. Véronique, elle, se détend. Elle n’a jamais compris l’expression : ennuyeux comme la pluie. Cette saucée au contraire la repose. Les essuies-glace balaient l’incessant dégoulinement des eaux. Leur va et vient, comme un métronome, scande les rares moments de silence.
– Tu sais à quoi je rêve ?
Véronique, prudente, fait des yeux ronds, ne répond pas.
– Et ça me prend souvent !
– Ha bon !
– A écrire !
– Ecrire ?
– Ecrire, oui.
– Des rapports ?
– Non, pas des rapports ! Ni des manuels. J’en écris à longueur d’année des rapports. Non, mon rêve, c’est d’écrive des romans.
– Des romans ?
– Et quel genre de romans, figure-toi ?
– Sais pas.
– Des romans policiers !
– Des romans policiers ?
– Oui des polars, quoi ! J’adorerais écrire des polars.
– C’est drôle ça !
– C’est ce que tout le monde me dit : c’est drôle de vouloir écrire un polar quand on est flic. Mais je ne vois pas pourquoi ? Il y a pas de rapport, si j’ose dire !
– Bin si, quand même un peu.
– Non, il n’y a pas de rapport. Il y a même un monde entre l’enquête et le roman. L’enquête, c’est d’abord des corps déchiquetés, des proches hystériques et le pire…
– Oui ?
– Oh, le pire… c’est l’odeur. Ça pue, la mort, c’est pas croyable ce que ça pue ! Au bout de quelques heures, bien sûr. L’odeur, je te jure, c’est ce qui a de plus pénible dans ce boulot. Une odeur qui colle à la peau, on a l’impression de la trimballer sur soi.
Il fait un geste de la main devant son visage comme pour chasser un fantôme.
– Et puis une enquête, c’est austère. On passe la moitié du temps sur l’ordinateur, à pianoter ; et l’autre moitié à « planquer », à pister d’éventuels coupables. On s’ennuie beaucoup dans ce boulot, tu sais ?
– ?!
– Mais dans les romans, pas de cris à subir, pas de viande explosée sous les yeux, pas d’odeur, surtout, pas d’odeur ! Et pas de temps mort, non plus. On court tout le temps ; on se marre, souvent. Et puis pas de paperasses à remplir. Le pied, non ?
Un ange passe.
– Alors, tu veux toujours être flic ?
– Mais j’ai jamais voulu !
– Je rigole !
La radio de bord interrompt soudain leur colloque. Une sonnerie aigrelette. Il s’excuse auprès de la jeune femme, prend l’appel.
– Chef, c’est Noël.
– Mon adjoint, murmure-t-il à Véronique.
– Chef, vous n’êtes pas seul ? Je dérange ?
– Pas de problème.
Le brigadier dit être allé interroger le responsable de la petite communauté kurde qui stationne en bas de l’immeuble de Kougelman.
– Il parle un sabir franco-anglais, j’ai pas tout compris. Il prétend n’avoir rien vu, rien entendu. « …rien vu, nobody ! » qu’il disait. J’ai haussé le ton, menacé de l’embarquer. Le kurde a retrouvé, un peu, la mémoire. Il a gardé le vague souvenir, dit-il, d’un homme…
– Un seul ?
– Oui, un seul. Il traînait dans le quartier lors du fameux « pont ». C’est tout ce qu’il a accepté de me donner. Il a ajouté simplement qu’il portait un casque.
1. L’homme ?
2. Oui.
3. Comment ?
4. Blanc !
5. Quoi ?
6. Le casque. Blanc.
– Un motard, sans doute.
Etait-il jeune ? vieux ? grand ? petit ? blanc ? noir ? L’autre s’est dit incapable de le préciser. Il n’avait pas repéré non plus de moto.
– C’est maigre, chef. Désolé.
– Ça va.
– Je fais quoi ?
Boreli lui d’aller au service des archives de la fac de médecine. Un documentaliste leur a promis, non sans mal, la liste de tous les employés pendant la guerre. Des fois que l’itinéraire d’Ernest Kougelman passerait par là. Dès qu’il aurait l’info, Noël devait lui faire signe.
– Compris ! Au fait, j’ai croisé Pfimlin !
– Et alors ?
– Il répète dans les couloirs que c’est un coup du tueur de mandarins !
– Je m’en doutais… Bon, salut, à lundi.
Lundi, c’est sûr, à la première heure, son chef sera dans son bureau. « Avancez un peu plus vite, cette fois ! » va-t-il glapir. Un peu plus vite, ce sera pas trop difficile.
– C’est quoi ce tueur de mandarins ?
Véronique vient de tirer le capitaine de sa rêverie
− C’est ta dernière enquête ?
Elle demande pour la forme et s’attend à ce que l’autre réponde qu’il est tenu au secret. Elle aurait même trouvé ça normal. Au contraire, il se déboutonne en précisant juste que c’est « off » :
– C’est pas à la journaliste que je m’adresse mais à « l’amie d’Thomas ! ».
Il raconte sa visite du matin à « l’aquarium », commente :
– Je suis chargé de ce dossier depuis le début. Et cette affaire ne m’inspire pas. Je ne sens pas les victimes, je ne sens pas le mobile, je ne sens pas le tueur, je sens rien quoi. Je ne me sens pas moi même. C’est la première fois que ça me fait ça.
– Sec ?
– Sec de chez sec ! Mon seul titre de gloire, c’est d’avoir réussi pour l’instant à tenir la presse hors du coup. On aurait voulu étouffer l’affaire qu’on n’aurait pas fait mieux ! Je me demande même parfois si c’est pas pour ça qu’on m’a laissé l’enquête.
– Tu m’expliques ?
– Dans cette affaire, on a déjà quatre crimes…
– Quatre ?
– En comptant celui d’Ernest Kougelman, oui, quatre. Et il n’y a toujours pas d’échos dans les canards locaux, faut le faire, non ? Un petit exploit !
En fait, Boreli n’est sans doute pour rien dans cet escamotage. La chance l’a aidé, si l’on peut dire. Les victimes, parfois d’anciens notables pourtant, n’étaient plus à la mode. Tous des retraités. Des ombres déjà. Et puis les crimes étaient espacés. Personne dans la presse ne semblait vraiment avoir fait le lien entre ces disparitions. En quatre ans, on a le temps de penser à autre chose. Enfin, comme un fait exprès, lors de chaque mort, une actualité spectaculaire accaparait les médias ! Comme les rats suivant Hamelin, les journalistes s’acharnaient sur l’info convenue et foutaient au flic une paix royale. Le premier meurtre coïncida avec la canicule qui monopolisait toute l’attention. Lors du second crime, on n’vait d’yeux que pour le Proche Orient où l’on se massacrait à nouveau avec entrain. L’an passé, hors la présidentielle, rien d’autre ne comptait. Dans ce permanent tintamarre, sa partition à lui était inaudible. Il n’allait pas s’en plaindre. Son chef mis à part, il n’y avait personne pour lui reprocher son manque de flair.
Les trombes d’eau composent et recomposent sur le pare-brise de mystèrieuses figures, des arabesques dégoulinantes, une éphémère cartographie.
1. Comment tout a commencé ? Cesare et Véronique, parfaitement synchronisés, prononcent en même temps la même phrase. Elle, par curiosité et lui anticipant sa demande. Ils rient de cette concordance.
« Le premier mort remonte à trois ans, très exactement à la mi mai 2005.
Comment s’appelait déjà le bonhomme ? Mon problème, un de mes
nombreux problèmes, c’est la mémoire des noms. S’en souvenir est
toujours un calvaire. Je les efface aussi vite que je les entends. Je ne m’en
sors qu’en bricolant des fiches. Qu’il m’arrive de paumer ! Ça m’aide pas
trop dans les enquêtes.
– Alors, le premier ?
– Le premier de la liste était un certain…Birdof, voilà, Rolf Birdof. Un toubib, enseignant à ses heures à l’Université. Le bonhomme s’était enrichi sur le tard. Il avait, dit-on, quelques intérêts dans des produits pharmaceutiques. Selon son entourage, c’était un octogénaire fatigué mais coriace. »
Rolf Birdof était pensionnaire d’une maison de retraite située dans les faubourgs chics de Strasbourg, un établissement haut de gamme où de petits pavillons médicalisés, coquets, s’étalaient dans un immense parc verdoyant. Le lieu offrait toutes les commodités possibles, bain, hammam, jacuzzi, salle de sport, de danse, etc, version troisième âge bien sûr. Mais friquée. Un endroit ultra-protégé, aussi, un ghetto de vieux riches entouré d’un impressionnant mur d’enceinte, percé de deux points de passages, de vrais check point, gardés en permanence par des agents de sécurité paranoïaques.
Prospère, le docteur Birdof avait pris le programme le plus cher et payé des mois d’avance. Ça devait être le genre prévoyant. Il n’avait pourtant pas tout planifié, la preuve.
Le vieux était la coqueluche des résidants, des femmes pour l’essentiel. Il avait ses habitudes, ses journées étaient réglées comme du papier à musique : promenade, déjeuner dans sa chambre, sieste, sport, dîner en groupe.
Les pensionnaires en effet prenaient le repas du soir en commun dans le restaurant classieux du site.
Ce soir-là, il manquait à l’appel. Un haut parleur diffusa son nom à plusieurs reprises, dans les résidences, les salles de jeux, sur les promenades, en vain. La directrice, Madame Winterhalter, chignon strict mais vrai sex-appeal, le style beauté retenue, comme les héroïnes de Hitchcock en un peu plus lourd, peut-être, sillonna le parc avec sa brigade sécuritaire tout en l’appelant sur son portable. L’autre était sur répondeur ; elle finit cependant par localiser l’appareil, il sonnait du côté du sauna. C’était un bâtiment isolé, qui avait la forme d’un chalet miniature ; il se composait d’une petite salle d’attente, ou sas de déshabillage, et de l’enceinte proprement dite du sauna, en bois blond, où l’on accédait par une porte étroite. Le téléphone était dans l’entrée et le propriétaire dans le bain de vapeurs. Mais dans un tel état que la directrice jugea bon de ne rien toucher et d’appeler aussitôt les flics.
Boreli se rendit sur les lieux. Le capitaine se souvient qu’en arrivant au centre, baptisé « Maison Alexis Carrel », une fois franchies les chicanes de l’entrée, il eut l’impression de se trouver au milieu d’un green de golf. La journée avait été très chaude, une batterie de jets d’eau, pivotant par a-coups, aspergeait la pelouse dans un concert de sifflements aigus très énervants.
Il découvrit donc la scène telle que Winterhalter l’avait vue, à peine une demi-heure auparavant.
Dans le sas, l’imposant banc de bois, sur lequel les vêtements étaient soigneusement pliés, n’était manifestement pas à sa place ; il avait été poussé en travers de l’entrée du sauna ; et pour bloquer définitivement cette ouverture, deux cales étaient fichés dans le pourtour de la porte.
De l’encadrement s’échappait une sorte de mousse, blanchâtre et nauséabonde.
C’est surtout le hublot qui retenait l’attention. De l’autre côté de la petite vitre, on distinguait d’abord comme une tâche noire surmontée de deux points rouges ; il fallait une fraction de seconde pour reconstituer le motif : c’était le visage du mort…
« Un peu comme la tête du personnage du Cri d’Edouard Munch » dit le capitaine.
L’occupant du sauna avait collé sa bouche sur le verre, espérant être entendu ou y cherchant vainement de l’air, mais ses yeux semblaient sortir des orbites et savaient bien qu’il était trop tard.
Cette tête était auréolée par une manière de brouillard auquel le luminaire du sauna donnait une couleur étrangement mordorée. C’était bel et bien Birdof. Boreli tenta d’imaginer ses derniers instants.
Quelqu’un s’était glissé dans le sauna, à l’insu du vieillard ( peut-être somnolait-il ?) ou avec son accord (un intime mais c’était peu probable) ou encore en usant de violence. Cet intrus non seulement avait poussé le chauffage au maximum – il devait faire plus de 100 degrés dans la cabine- mais il avait jeté sur l’appareil un produit qui avait dégagé une fumée toxique étouffante.
Le laboratoire dira plus tard qu’il s’agissait d’un gaz à base de sulfure d’éthyle, que les militaires appellent ypérite, ou encore gaz moutarde.
L’agresseur, une fois ressorti, avait bloqué la porte, Birdof était fait comme un rat ; impossible d’échapper au piège ; il pouvait toujours hurler, le son ne passait même pas l’enceinte du sauna. Le lieu étant relativement retiré, il n’avait aucune chance. Il aurait pu avoir le réflexe de réduire la température de l’appareil mais ça ne servait déjà plus à rien. Le poison avait dû lui retourner la tête et les poumons.
« Non seulement son visage était plaqué à la vitre mais ses mains étaient agrippés à la paroi, ses ongles incrustés dans le bois, comme s’il s’était lui même épinglé au mur, vieil insecte de collection. Il est d’ailleurs resté collé à la porte une fois mort. Birdof m’a semblé poussé là autant par la peur que par la haine. Cette posture, par la suite, m’a littéralement hanté.
– Pourquoi ?
– J’ai comme la conviction qu’ils se sont regardés, de part et d’autre de la vitre, l’agresseur et l’agressé.
– Se connaissaient-ils ?
– Je n’en sais rien mais je te le dis : ils se sont regardés.
– C’est étrange. L’assassin aurait dû plutôt fuir, son forfait accompli.
– Etrange, peut-être, mais je suis à peu près sûr que le tueur s’est comporté en voyeur. Je l’imagine, témoin glacé, préservé, manipulateur. Il observait l’autre qui l’observait. A travers le hublot. Comme si le spectacle faisait partie du supplice. Comme si croiser le regard de l’autre comptait autant que sa mort, participait à sa mise à mort ».
Il a fallu prendre des précautions pour ouvrir la cabine. On fit appel à un agent revêtu d’un scaphandre. Le corps du vieillard était boursouflé, gonflé, sa peau était recouverte d’ampoules comme s’il s’était roulé dans un champ d’orties. Les conditions de cette mise à mort étaient particulièrement sadiques. Et incompréhensibles.
« L’infirmier chargé de suivre ce patient de luxe fut viré dans la semaine. Je l’avais interrogé, il n’y était pour rien, il entreprenait au même moment une antillaise gironde, forcément gironde, dans les cuisines. Mais son expulsion permit de calmer, un peu, les esprits dans l’établissement, de trouver un bouc émissaire à bon marché. Surtout que le soignant était un étranger.
– C’est à dire ?
– Les pensionnaires insistèrent sur son drôle d’accent. De l’Est. Entre parenthèses, parler d’accent à Strasbourg, c’est plutôt rigolo, mais passons. Les uns me dirent que c’était un Kurde ; pour d’autres, il ressemblait à un Polonais. Une rombière m’assura même qu’il s’agissait d’un Babylonien ! Elle voulait dire : Macédonien… »
Boreli se mit en quête de témoignages. Un pensionnaire prétendit avoir aperçu une femme louche dans les parages. Renseignement pris, il s’agissait de Mme Winterhalter. Le vieux se confondit en excuses. Un autre parla d’un jeune « pas d’ici », il désignait en fait le livreur de pains, un beur à l’alibi en béton. Et ainsi de suite. Quelqu’un parla encore d’un homme « en blanc ». « Tu parles d’un indice ! ». Ce fut tout. Quant à la bio du vieux toubib, elle était lisse de chez lisse : jeune résistant, puis chercheur apprécié, biznessman reconnu enfin. Point.
Le capitaine met en boucle, et en sourdine, « Le beau Danube bleu » de Strauss. Johann, pas Richard. Dans la version space où Kubrick fait valser les planètes dans son « 2001. L’odyssée de l’espace ». La main droite de Boreli plane, s’envole, tourbillonne. Du klaxon, il rythme la mélodie, que reprend Véronique : Do, do, mi, sol, sol, sol, sol, mi, mi, do, do, mi sol, sol…
– Tu connais l’année de cette musique ?
– Le Danube bleu ?
– Version Kubrik !
– ?!
– 1968.
Il fait nuit quand ils arrivent enfin à l’entrée de Rodinger. La vitrine du café-hôtel-restaurant brille comme un phare. Il n’y a d’ailleurs que le « Jérusalem » qui scintille dans les ténèbres.
4
STRASBOURG, été 1945
Gris
Pour ne pas perdre la main, m’aider aussi à mieux percer cette personne peut-être, j’ai passé une partie de nuit sur le portrait de Mlle Adler ; il n’est pas question de la faire poser, bien évidemment, je travaille de tête ; et puis je m’aide de temps à autre d’une photo d’identité que j’ai punaisée sur le chevalet. J’ai trouvé dans une papeterie du centre ville des toiles, des tubes de peinture de très médiocre qualité mais on ne va pas faire le difficile. Peindre a, pour moi, l’étrange propriété tout à la fois de me détendre et de me concentrer, je ne peux pas mieux dire.
Helena Adler était la secrétaire d’August Hirt, une adjointe parfaitement bilingue comme le souhaitait le professeur ; elle est actuellement retenue dans la caserne où je réside.
Cette strasbourgeoise risque la prison pour collaboration. Je la ménage car son témoignage m’est capital pour comprendre le fonctionnement de l’Institut et de l’Université, pour mieux cerner aussi la personnalité de son « patron ». Et puis je confesse une coupable compassion pour cette jeune femme qui est enceinte, elle semble même être dans les tous derniers moments de sa grossesse. Pour tout vous dire, mon commandant, et sauf contrordre de votre part, je compte au terme de cette instruction lui fournir un passe-droit. Après tout, elle n’exerçait que des fonctions administratives. Et puis que lui souhaiter de mieux que de se faire oublier ?Et de s’occuper de son futur bébé ?
Le teint pâle, Mlle Adler semble uniformément grise. Elle a des cheveux longs et gris-argentés, ce qui est tout à fait impressionnant vu son jeune âge ; ils sont ramenés en deux nattes roulées sur l’oreille. Ces macarons lui donnent un air sévère qu’accentue encore le port, invariable, d’un tailleur strict et gris, lui aussi. Ses yeux gris clair déroutent le regard de l’ autre, sa bouche étroite laisse passer le minimum de messages.
Son gris est une couleur de cendre et de brouillard, de deuil et de mélancolie et la rondeur de son ventre semble ne rien y changer. Il paraît que le gris est la première couleur que découvre l’enfant en venant au monde ! Entre noir et blanc, jaune et bleu, rouge et vert, le gris – si j’étais méchant, j’ajouterais : le vert de gris- est bien sa couleur de prédilection.
Mlle Adler est distante, impavide, froide. Les rares moments où elle s’anime, où elle sort d’elle même, si je puis dire, c’est quand elle évoque son travail ! Elle présente cette étrange particularité des gens d’ordre : elle n’a pas émis le moindre doute, ni le plus petit regret, sur sa fonction dans la machine nazie ; jamais une réserve sur l’attitude de ses anciens patrons ; jamais une critique, ni autocritique. Elle était pourtant au fait de tous les agissements de l’administration, en tout cas au niveau de l’Institut. En même temps, respectueuse par principe de l’autorité, elle n’a pas beaucoup hésité à collaborer avec mes services, dès que je l’ai sollicitée. Toujours avare de ses propos, elle a cependant répondu avec rigueur et scrupule, avec le même professionnalisme, j’imagine, qu’elle avait mis au service de son précédent maître. Le pouvoir change, et elle, elle sert le pouvoir. Telle semble être sa morale.
Mélomane averti, August Hirt suivait de près l’actualité musicale. Durant l’hiver 1941-42, il avait beaucoup été question, dans la presse allemande, de la représentation de « Tristan et Isold » à Paris sous la direction de Herbert Von Karajan. Mais le professeur Hirt aimait plutôt Strauss que Wagner. Son grand regret, selon Mlle Adler, était de ne pas avoir pu assister à l’opéra de Richard Strauss, « Elektra », à Karlsruhe, où Agamemnon tue Iphigénie, Clytemnestre tue Agamemnon ; et Electre tue Clytemnestre. Cette hystérie lyrique l’exaltait.
Il avait toute la collection des microsillons disponibles du musicien et il repassait volontiers « Salomé », surtout la scène où la fille d’Hérodiade, après avoir dansé pour le roi Hérode, obtient la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d’argent et baise le chef coupé.
August Hirt, excellent francophone au demeurant, était très remonté contre les Français qui n’avaient pas aimé cet opéra. Rancunier, il se souvenait des échos de la presse parisienne d’avant guerre ; celle-ci avait parlé de « drame épileptiforme », de « cauchemar de la Salpetrière », de « germe morbide », de « névrose »… Il en voulait particulièrement à Romain Rolland qui avait osé accuser Strauss de mettre en scène « des êtres malsains, malpropres, hystériques ou alcooliques, puant la corruption mondaine et parfumée » !
Crétins de Français !, disait Hirt, ils ne comprennent décidément rien à Strauss. Comparer ses rythmes à de l’épilepsie et trouver ses mélodies morbides le mettait en rage. Et médire de Salomé ! Pour lui, c’était la femme fatale, la sœur de la mort, l’ensorceleuse, la femme serpentine, la Femme, tout simplement ! Toutes les femmes n’étaient-elles pas des Salomé, innocentes et monstrueuses à la fois.
August Hirt aimait tout de Strauss ; mais il avait un faible pour ses lieder ; il connaissait par cœur ces miniatures maniérées, ces petits poèmes désuets, et les entonnait volontiers, a cappella bien sûr, aux moments les plus improbables. Dans les couloirs de l’Institut ou en salle d’opération, à la fin d’un cours ou en pleine réunion. Celui qu’il préférait était sans conteste « Zeitlose », le colchique :
Auf frisch gemähtem Weideplatz
Steht einsam die Zeitlose…
Sur le champ fraîchement fauché
Se tient solitaire un colchique…
Mlle Adler insiste pour que l’on ne fasse pas du professeur Hirt un « mouton noir », c’est son expression. Toute l’administration universitaire, dit-elle, était au courant de ses activités. Qu’il s’agisse du doyen de la Faculté de Médecine, le professeur Stein, ou même du recteur de l’Université allemande de Strasbourg, le professeur Schmidt. Ce dernier n’était autre que le directeur de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital civil. Or cette clinique est située juste en face de l’Institut d’Anatomie. Tout ce qu’a fait August Hirt le fut avec l’accord et l’assentiment de ces deux notables, entre autres, tous deux membres influents du parti nazi : telle est la conviction de sa secrétaire.
Installé dans ses nouvelles tâches à l’université de médecine, contrôlant de près la réalisation de son laboratoire au Struthof, entouré d’une équipe ardente de toubibs allemands, elle-même épaulée par quelques collaborateurs alsaciens, August Hirt passe l’hiver 1941- 42 dans une ambiance de travail et d’émulation. Et il est alors traversé par une idée fulgurante. Il sait, il pressent que la solution finale est en route ; il se dit que « la race juive », plus exactement la « race judéo-bolchevik » ou la « race des commissaires » comme il aime aussi la nommer, est sur le point d’être anéantie. Il faudrait donc en conserver des vestiges, réunir des « spécimen » tant qu’il en est encore temps, garder la trace d’un monde en voie de disparition, en conserver quelques restes. Non comme hommage, certes, mais comme trophée, comme signe de victoire aussi de l’Allemagne et de sa science qui ont su débarrasser l’humanité de ses tumeurs. Il va proposer de faire de Strasbourg, de sa fac de médecine, de son institut d’anatomie le futur grand centre de documentation de cette sous-race, un musée en quelque sorte des êtres inférieurs disparus. Un musée du Juif ! Pourquoi ? Pour les besoins de la science, pour l’édification des générations futures, pour la beauté du geste, tout simplement.
Le clou de cette installation serait une collection de squelettes ; plus exactement un alignement unique de crânes, de jeunes et d’adultes, d’hommes et de femmes. 150 crânes alignés comme à la parade et qui parleraient des temps anciens.
J’y vois, mon commandant, comme un lointain écho à ces cérémonies celtiques où dignitaires et prêtres exhibaient les crânes ornés d’un cercle d’or de leurs adversaires et s‘y livraient à des libations.
Moderne barbare, August Hirt devait s’imaginer que l’on viendrait des quatre coins du Reich, en famille, pour visiter sa collection, une fois que la guerre ne serait plus qu’un mauvais souvenir, quand les aryens triomphants et assurés, tout pleins de leur évidence, souhaiteraient se rappeler à quoi ressemblaient déjà les « autres », montrer le mal auquel le monde avait échappé, confirmer encore et encore leur triomphe final, total.
Peut-être se voyait-il déjà commenter doctement ces restes de sous-races à un public de choix, à ces chers chevaliers de l’ordre noir, et pourquoi pas
au Führer en personne, ébaubi autant par cette enfilade de têtes que par ses propos éclairés ? Sans doute se rêvait-il, désinvolte et compétent, tapant de sa badine ces calottes numérotées et raconter l’ascendance, l’itinéraire, les caractéristiques de chacune d’entre elles avec une extrême précision…
L’idée, se dit-il, ne peut que plaire à Berlin.
Il en fait part, je l’ait dit, je crois, à son ami Wolfram Sievers de « L’héritage des ancêtres », lequel partage entièrement son désir et lui conseille de mettre noir sur blanc ce projet qu’il se charge de transmettre à Heinrich Himmler.
Le professeur convoque sa secrétaire. Celle-ci affirme se souvenir parfaitement de la dictée de cette lettre et du jour où cela se passa. Non seulement parce que ce courrier est « solennel », selon son expression, mais surtout parce qu’il coïncide avec l’anniversaire de la jeune femme. Vingt-cinq ans ! Ce même-jour, en effet, elle a droit à des égards particuliers de l’ensemble du service. Les collègues se sont cotisé pour lui offrir un manchon en astrakan, plus exactement de breitschwanz, gris bien sûr, dont elle faisait usage en toute saison
Le professeur, dit-elle, d’ordinaire si maître de lui, est anormalement tendu ; il marche de long en large dans le bureau tout en cherchant ses mots. A chaque silence, parfois long, elle regarde le gel qui recouvre les vitres du bureau de la direction. Elle a toujours été fascinée par la parfaite géométrie de ces dessins. Pour elle, c’est la preuve de l’existence de Dieu, me confie-telle, impénétrable.
Trouver Dieu dans la forme d’un dessin n’est pas une idée pour me déplaire mais je me suis bien gardé de pousser la discussion. Moi, je n’ai jamais prétendu rencontrer le divin dans un tableau, encore moins dans les miens. Pouvoir juste tutoyer la beauté, ou transformer la laideur, me suffit amplement.
August Hirt dicte :
« Il existe d’importantes collections de crânes de presque toutes les races et peuples. Cependant, il n’existe que très peu de spécimens de crânes de la race juive permettant une étude et des conclusions précises. La guerre à l’Est nous fournit une occasion de remédier à cette absence. »
Comme je lui demande ce qu’elle pense alors de tels propos, d’un tel projet, la secrétaire prétend qu’elle a du mal à tout comprendre immédiatement car elle est concentrée sur le mot à mot ; quand elle prend en sténo, elle est obsédée par chaque expression et l’ensemble perd un peu son sens ; elle ment bien sûr mais avec un tel aplomb. Et puis je ne veux pas la braquer, j’ai trop besoin de ses confidences…
« Nous pouvons obtenir des preuves scientifiques tangibles en nous procurant des crânes de commissaires juifs, bolcheviques, qui personnifient une humanité inférieure, répugnante mais caractéristique ».
Je reprends au mot à mot ses expressions : « des crânes de commissaires juifs, bolcheviques » et « une humanité répugnante mais caractéristique » ; le patron de l’Institut poursuit :
« Pour la conservation et l’étude du lot de crânes ainsi obtenus, la nouvelle Université d’Etat de Strasbourg serait le lieu qui conviendrait, en raison des buts et des tâches qui lui ont été assignés ».
Voilà donc le plan du professeur Hirt : faire de son centre strasbourgeois le lieu d’excellence de l’Empire en matière de recherche –et d’exposition- sur les « sous-races » …
« Le meilleur moyen d’obtenir rapidement et sans trop de difficultés cette collection serait de donner des instructions pour qu’à l’avenir la Wehrmacht remette vivants à la police du front tous les commissaires bolcheviques juifs. La police les gardera jusqu’à l’arrivée d’un envoyé spécial. »
August Hirt précise alors que l’ « envoyé spécial » en question peut être un « jeune médecin » ou un « étudiant en médecine » appartenant à son équipe et ajoute :
« Celui-ci, chargé de réunir le matériel, devra prendre une série de photographies déterminées à l’avance, effectuer des mesures anthropologiques. Il devra s’assurer autant que possible de l’origine, de la date de naissance, et le maximum de détails personnels sur les prisonniers. »
Les mots disent bien la sauvagerie des choses. On ne parle déjà plus « d’humanité inférieure » mais de « matériel ».
« Après la mort de ces juifs dont on prendra bien soin de ne pas endommager la tête, il séparera la tête du tronc et nous l’adressera dans un liquide conservateur ».
5
Vendredi 13 mai
22h30
« Descendez les flics.
Camarades
Descendez les flics ! »
Serge Aigle, sur le pas de la porte, « aragone » en guise de bienvenue. Il a le visage étroit, énergique, buriné. Le costar blanc en lin, fatigué, le panama, couleur crème, lui donnent un genre dandy pauvre. Derrière lui, Georges Federmann-Dutriez, long, sec, cheveux bruns-noirs, coupés très courts, petite barbiche est un mélange d’ardeur et de tendresse. Il a un côté imprécateur tranquille. Il porte un ensemble de toile bleu.
Tous les ans, à la mi mai, Boreli appâte quelques amis pour organiser sa stammtisch rituelle, une cérémonie commémorative et privée. Les invités ? Des anciens de la fac de Strasbourg, vétérans de 1968. Le chiffre des participants varie. Il est monté une fois à dix, le plus souvent ils sont une demi-douzaine à faire le voyage mais le noyau dur, c’est Georges, Serge, Thomas Cavaignac et lui.
« Quatre, le beau chiffre, dit Véronique. comme les points cardinaux ou les piliers de l’univers.
– Comme les saisons.
– Ou les cavaliers de l’apocalypse ! »
C’est en 1998, pour les trente ans des « événements », que Boreli avait eu l’idée de réunir, autour d’une table, ces vétérans. Il fournissait le lieu, un café-hôtel-restaurant, qu’il venait d’acquérir.
L’immeuble est situé à Rodinger, son village natal. Les gens du coin ont toujours appelé ce commerce « Jérusalem », il n’a jamais très bien su pourquoi. On devine encore l’appellation, délavée, sur la façade. Difficile pourtant d’imaginer le paradis dans cette grosse bâtisse sans style de deux étages.
Les Boreli avaient longtemps logé là, dans un deux pièces-cuisine, un meublé au dessus du café, avant d’obtenir un logement dans une cité de mineurs. Dès le lycée, Cesare s’était éloigné du village et des siens.
Apprenant, des années plus tard, la mise en vente du « Jérusalem », il avait eu l’idée de racheter le bâtiment, et le fond de commerce. C’était comme une dette envers ses parents, décédés. L’affaire était bon marché, on peut même dire bradée. D’abord parce que le bled était un peu spécial. Et puis il avait repris la patente du commerce, à la condition d’ouvrir le café au moins une fois l’an. En général, ce jour-là coïncidait avec la stammtisch. Il n’y avait d’habitude pas le moindre pékin mais il fallait respecter le cahier des charges, se déguiser en bistrotier pendant vingt-quatre heures. Les chambres aussi, une demi-douzaine, attendaient vainement le chaland. Le reste de l’année, la boutique restait fermée mais demeurait à la disposition du groupe : venait qui voulait, la clé était chez un voisin. L’idée de retrouver les anciens de 68 dans ce village du nord-est alsacien, à deux pas de la frontière allemande, était hasardeuse. Mais la première rencontre fut concluante. Tout se passa bien. Les anciens étaient même si contents que Boreli répéta l’opération puis la systématisa. Ces réunions avaient un côté un peu maniaque mais pour Cesare, c’était mieux que de se revoir pour les enterrements.
Les vétérans se tombent dans les bras les uns les autres.
Véronique reste en retrait. Ils finissent par la découvrir.
– On nous a changé notre Thomas !
– On ne perd pas au change.
Federmann-Dutriez est psy, ou cinéaste, ou les deux. Comme tout le monde parle en même temps, Véronique n’a pas tout saisi. Aigle, lui, fait dans l’humanitaire.
« Des samaritains » dit d’eux le flic.
La salle du café-restaurant est rangée, la table pour le dîner est mise. Un peu partout, au mur, des photos retracent les grands moments de mai 68 à Strasbourg. Les épreuves sont de Boreli. Il traquait à l’époque les inscriptions peintes sur les façades d’immeubles, les entrées de bâtiments universitaires, les murs d’amphis. Il a accroché ici ses meilleurs clichés. Le trio commente, s’émeut
Un slogan, direct, propose : « Mangez vos professeurs ».
« Tu te souviens où c’était ?
– Salle Fustel de Coulanges ?
– Non.
– Fac de lettres ?
– Non : Ecole de Chimie ! »
Une autre reproduction, dans la cuisine, suggère :
« Ne dites plus : SVP, M. le professeur, dites : Crève, salope ! »
« Tu sais que plus aucune porte ne ferme, dit Georges.
– Aucune fenêtre non plus, ajoute Serge.
– On m’a dit, oui.
Véronique trouve le sol étrangement gondolé mais s’abstient de tout commentaire. Boreli ne semble pas s’inquiéter particulièrement.
Ils passent à table. Tartes flambées à volonté, nature ou gratinée. D’ordinaire, c’est Boreli qui régale, à l’italienne. Les années précédentes, il leur a fait des cannelloni au parmesan, des rigatoni aux champignons, du risotto printanier. Tout de sa composition, s’il vous plaît. Du basique mais du bon. Avec, en prime, une leçon de cuisine pour ceux qui voulaient prendre des notes ! Sur son ordinateur au bureau, le fichier le plus étoffé est celui qui traite de recettes ! Ce soir, il est arrivé trop tard. Il se rattrapera demain.
A peine installé, Federmann-Dutriez entame ce qui semble être son morceau préféré : l’Alsace. La patrie du refoulé, dit-il, de l’amnésie organisée. Conviviale mais taiseuse.
« C’est qu’on n’aime guère parler du passé, ici ?
– Comme tout le monde, non ? Plaide Véronique, qui pense à ses passages à vide, il n’y a pas si longtemps, sur le divan.
Le psy riposte :
« Peut-être. Mais il s’agit des miens et leurs silences honteux me tuent. L’omerta est aussi une vertu alsacienne. Chaque fois que je l’ouvre, je tombe sur un flic de la pensée, excuse moi, Cesare, pour me dire : « Il faut tourner la page, Federmann, il faut tourner la page ! C’est du passé tout ça ! ». Mais on l’a même pas lu, la page, et eux voudraient déjà la tourner.
Federmann-Dutriez travaille à un documentaire sur le camp du Struthof, « un camp méconnu, pour ne pas dire plus ». Il vient de dénicher aux archives une scène sidérante. On y voit un préfet mettre le feu aux baraques du camp.
« Le seul camp de concentration nazi en territoire français. Génial, non ?
– C’était quand ?
– Ça s’est passé le 29 mars 1954 très exactement, lors d’une cérémonie officielle. Le préfet de la République s’appelait Paul Demange. On voit cet officiel, personnage volumineux, une torche à la main, qui incendie méthodiquement les bâtiments du camp. Derrière lui, toutes les huiles, en rang d’oignons, sont au garde-à-vous, galonnés de l’armée, élus, porte-drapeaux du « Souvenir français » ! Presque tout le camp partit en fumée. N’échappèrent à l’incendie que trois ou quatre baraques témoins ! »
Federmann a un ton de Savonarole :
« Le préfet parla de « purification par le feu ». Purifier par le feu ? Vous imaginez un peu ? Qu’est-ce qu’il veut brûler, le gros Demange ? L’épouvante nazie ? Les tortures infligées aux déportés par des médecins SS, pudiquement qualifiées par un officiel de « recherches anatomiques » ? Qu’est-ce qu’il veut cramer, bon Dieu ? Le four crématoire ? La mémoire ? L’Histoire ? Circulez, il n’y a plus rien à voir ! On efface tout ! La presse locale alors est enthousiaste. Le matin même de cette invraisemblable cérémonie d’Etat, Les Dernières Nouvelles d’Alsace titraient : « Ce soir, les baraques n’existeront plus ! »
– C’est fou, cette histoire ! S’émeut Véronique.
– Attendez. C’est pas fini. Ce Demange en question n’est pas n’importe qui. Il avait été, durant la guerre, chef de cabinet de l’amiral Darland, ministre de l’Intérieur de Vichy, un temps successeur désigné de Pétain !
La journaliste le regarde tonner.
Boreli joue les modérateurs, réclame une pause. Georges bougonne. Serge débarrasse. Le capitaine se met en quête d’un Gewurztraminer pour le dessert. Il invite Véronique à découvrir sa cave. Ils s’y aventurent par un vieil escalier en colimaçon qui branle et grince. La spirale infernale. Pour Cesare, l’association d’idées est immédiate : il repense au troisième mort de son enquête, le mort de l’an dernier. Comme s’il reprenait la conversation de la voiture, il en fait part à la jeune femme.
Les investigations sur Birdof n’avaient rien donné. Le type était connu mais solitaire ; il n’avait plus de famille proche, personne pour faire pression. Son dossier traîna et prit une voie de garage. Près d’un an plus tard intervint le second meurtre du même tonneau. L’affaire Birmann. Encore un toubib.
« C’est à partir de ce nouvel assassinat qu’on a commencé, dans le service, à parler du « tueur de mandarins ». Ça remonte à 2006. Walter Birmann avait à peu de choses près le même âge que Birdof. Comme lui, il avait travaillé à l’université de médecine de Strasbourg et fricoté un peu du côté de l’Hôpital ! »
C’est là que Boreli avait été invité à le rencontrer. Enfin pas lui vraiment mais son cadavre. Quand l’interne, un certain André Gérold, jeune homme frêle et chauve, lui avait demandé de passer à son service, le capitaine n’avait pas tout de suite saisi. S’il fallait solliciter la police pour chaque mort dans ce genre d’établissement, on n’en sortirait plus. Mais Gérold, au téléphone, avait insisté. Son bureau était situé dans une annexe de l’établissement ; on y accédait par un escalier vieillot, en colimaçon. Sur place, ce soignant prit des précautions particulières : il fit enfiler au capitaine une blouse, des gants, des protège-chaussures, un calot et un masque, le tout d’une couleur vert pomme du plus bel effet. Ils traversèrent, l’un et l’autre ainsi déguisés, de longs couloirs déserts, poussèrent une enfilade de vantaux, franchirent des portes à code pour accéder finalement, après une descente par un escalier à colimaçons, à une chambre mortuaire. Le médecin se sentit obligé de préciser :
« D’ordinaire ces chambres sont rattachées directement à des services administratifs mais ici elle est restée liée au service d’anatomopathologie ».
Boreli enregistra l’information, en ne sachant pas trop ce qu’il allait en faire. La pièce n’était pas très grande, entièrement carrelée de blanc ; un néon diffusait une lumière violente. Le capitaine avait rarement vu un lieu aussi glacial, et pas seulement parce qu’il y faisait un froid de canard. Au centre, sur un chariot, une forme les attendait, sous une couverture. Vert-pomme, elle aussi. Ça devait être la couleur fétiche de l’administration ou celle-ci était peut-être tombée sur une promotion.
L’interne retira avec précaution le drap ; il découvrit le corps nu d’un vieillard, rouge, des pieds à la tête ; plus exactement, l’individu présentait toute une gamme de rouges, le visage amarante, le tronc brique, les bras carmin, le sexe incarnat, les jambes vermillon. Il avait la couleur de la congestion la plus vive, comme si cet homme avait été porté à l’incandescence, comme s’il dégageait un rayonnement calorifique, comme si ce n’était plus qu’un sac à sang prêt à vous exploser à la figure. Seul élément à échapper à cette vague pourpre, ses yeux, exorbités, d’un blanc sale. Son regard exprimait une stupeur insondable.
L’interne laissa au capitaine un temps d’adaptation.
La surprise à peu près passée, Boreli avança machinalement la main vers le défunt. D’un geste empressé, l’interne lui saisit le bras.
« Vaut mieux pas ! »
Il déclina l’identité du mort.
« Professeur Birmann. C’était mon tuteur en première année de médecine. Retraité. Il est entré dans mon service cette semaine, pour des troubles gastriques. Du classique. Au bout de vingt quatre heures, ça allait déjà mieux. Or, hier matin, on me sonne : Birmann avait une fièvre de cheval, il commençait à délirer, parlait de vengeance, de punition, de châtiment… Je constate l’apparition de plaques de rougeur, un rouge violent ; puis ces marques, très vite, vont se multiplier et recouvrir finalement tout le corps. Birmann semblait terrorisé, comme s’il était la proie des flammes de l’enfer. Excusez cette image baroque pour un toubib, mais c’est tout à fait l’impression qu’il m’a donnée. Il était littéralement submergé par la peur ; il parlait de diable blanc ; puis il est tombé dans le coma et cette nuit, il est mort. ».
L’interne se taît ; il veut s’assurer que le flic a bien tout suivi ; il reprend :
« On a fait une prise de sang. »
A nouveau, un silence. Boreli le presse :
– Oui ?
– Résultat de l’analyse…
L’apprenti toubib se faisait manifestement désirer. Le flic commençait à trouver agaçante sa manie de délivrer au compte-gouttes les infos, d’entretenir le mystère.
– Alors ?
– Le typhus !
Le Capitaine avait une vague idée de ce que cela signifiait. Pour lui, le mot résonnait comme un fléau d’antan. L’interne éclaira sa lanterne :
« Le typhus, aussi nommé typhus exanthématique, est le nom donné à plusieurs maladies infectieuses comme la leptospirose ictéro-hémoragique ou typhus hépatique, la purpura aigu, la fièvre jaune… »
Cesare Boreli opinait ; c’était la seule chose à faire.
« Il y a aussi une variété de typhus d’orient qu’on appelait la peste… »
La peste ! Terme impossible qui renvoyait Boreli à ses classiques, la peste de Londres, « un mal qui répand la terreur » disait La Fontaine, la peste de Camus. C’était comme une plongée dans un passé noir, dans la nuit des temps, presque un retour au cerveau reptilien.
« Le typhus est une maladie infectieuse, contagieuse et épidémique causée par la rickettsie.
– C’est à dire ?
– Une bactérie transmise par les poux. Les symptômes sont connus : Fièvre intense et brutale, exanthème purpurique généralisé, état de choc, hémorragies. Tout à fait les caractéristiques observées chez le docteur Birmann. »
Ils regardaient le corps coloré.
« On l’a immédiatement isolé dans cette chambre froide.
– Je compatis, vraiment, mais… pourquoi moi ? Je veux dire : pourquoi avoir fait appel à la police ?
– Vous savez, le typhus est une maladie qui a disparu de nos régions depuis longtemps.
– Vous avez peut-être des poux ?
– Capitaine ! S’indigna Gérold.
– Excusez-moi, je cherchais une explication.
– Personne n’a d’abord compris ce qui avait bien pu se passer. On a beau se dire qu’on vit une époque de régression, de là à retourner au Moyen Age. Et puis…
Le toubib recommençait ses devinettes. Ça devait l’amuser de jouer ainsi avec le flic.
– Et puis ?
– Regardez ça !
Il se pencha prudemment sur le corps, invita Boreli à faire de même. Il y avait, sous l’oreille gauche, une marque noirâtre, comme un baiser de la mort, un suçon de vampire.
L’interne reprit :
– Une trace de piqûre.
– De typhus ?
– De typhus ! Ça veut dire quoi ?
– ?!
– Qu’un cinglé est venu, il y a deux nuits de cela, avec une seringue, et sans doute un flacon contenant le germe, pour piquer Birmann. Non mais, vous imaginez un peu ?! »
Boreli n’imaginait pas ; pour l’instant, il constatait. D’abord qu’on n’avait retrouvé ni la seringue, ni le flacon en question. Ensuite, que Gérold était en verve :
« Comment il a fait…
1. Ou elle..
2. Pardon ?
3. Comment il ou elle a fait ça ! Ça peut être une femme, non ?
4. Ça peut ! Bref, comment il – ou elle, si vous voulez- a bien pu procéder pour que Birmann se laisse faire ?
5. Il a du se déguiser en infirmier.
6. Peut-être. Peut-être aussi que l’autre l’a endormi avant de le piquer, ou l’a assommé.
7. Mais le typhus ?
8. Oui ?
9. Ça ne se trouve pas comme ça, tout de même. Se procurer des germes de peste, c’est pas donné à n’importe qui, non ?
10. Ça, c’est votre travail, capitaine !
Une fois encore, Boreli fit preuve d’une sagacité limitée. Il rencontra le gardien de nuit qui avait donné l’alerte pour Birmann. Choqué d’apprendre qu’il avait pu être en contact avec le typhus, il n’arrêtait plus de se gratter, persuadé que la maladie lui collait à la peau. Le type ne fit que confirmer ce que le capitaine savait déjà. Il se rencarda sur l’organisation de l’Hôpital, la nuit. On y entrait comme dans un moulin ou presque ; les rondes étaient assez espacées pour permettre à quiconque de vadrouiller à sa guise dans les couloirs. Quant à se procurer des germes de typhus, dans la région, c’était plutôt difficile. Mais on pouvait trouver le produit à l’Institut Pasteur, à Paris. Il suffisait de montrer patte blanche ou d’y avoir ses entrées, ce qui était finalement le cas de pas mal de monde.
La famille Birmann était raisonnablement affligée. Le bonhomme était cossu et ses héritiers surtout préoccupés par le magot de l’aïeul. Boreli se voyait mal dans ces circonstances mettre à la question sa nombreuse descendance. Le seul indice vaguement intéressant se trouvait dans sa bio. Ou plus exactement dans la comparaison entre son itinéraire et celui de Birdof. L’homme du sauna et lui, le pestiféré, ne se fréquentaient pas, le premier ayant été généraliste en ville, aimant les mondanités, l’autre universitaire connu mais vivant au milieu de ses malades. Cesare voulut savoir s’ils avaient pu partager le même passé. Apparemment ce n’était pas le cas. Birmann avait été assistant à l’Institut d’anatomie de Strasbourg durant l’ocupation, Birdof, lui, se prévalant d’un titre de résistant pour des faits d’ames en région parisienne. Mais le flic fut bien incapable de trouver auprès des autorités et des associations de résistance la moindre référence à son malheureux client.
Boreli se plongea alors dans l’histoire de la peste. Qu’espérait-il y trouver ? Il remonta jusqu’à la Bible : « Le Seigneur envoya la peste en Israël depuis le matin de ce jour-là jusqu’au temps arrêté ; et depuis Dan jusqu’à Bersabée, il mourut du peuple soixante et dix mille personnes ».
Mais ça ne fit guère avancer son enquête. L’hôpital réussit à camoufler le crime. La peste dans les services, ça la foutait mal. Personne n’avait intérêt à paniquer les foules. La famille, qui ne pensait qu’à l’héritage, se tut. La presse itou, comme d’habitude. Faut dire que les Américains étaient partis dans une nouvelle croisade contre l’axe du mal et les bombardements écrasaient tout sur leur passage. Y compris les faits divers. Donc rien ne filtra, conclut Cesare
Le flic restait sidéré par la docilité des médias, leur promptitude à être aux ordres. Et en même temps, ce n’était pas pour le contrarier. Il ne cherchait pas trop la publicité.
« Il faut dire que l’enquête aussi était discrète… Mais allez, faut retrouver les autres. Ils doivent s’impatienter ! »
« Où vous étiez passés ? C’est louche ! » s’écrie Aigle. Véronique répond à son regard, se trouble ; elle s’en veut de cet émoi. Elle se dit alors que cet homme sera à elle. Elle n’est pas pressé et savoure déjà ce moment à venir. Le capitaine tente de se faire pardonner en leur servant un Gewurtz 1998.
« Vous m’en direz des nouvelles, la robe est ambrée, il tapisse bien le palais ».
Ils goûtent, apprécient. Boreli pérore :
« Pour le producteur, cette cuvée tient tout à fois du miel floral, du tilleul, de la rose, des fruits confits, de la mirabelle, de la figue, de la datte, de la gelée de coing… »
Les coudes se lèvent une nouvelle fois. Un ange passe.
« Alors ? C’est quand tu veux !
L’humanitaire provoque Véronique. Elle l’observe, étonnée. Un détail l’amuse. Serge présente un étrange symptôme connu chez les fins du pileux : au fil de la soirée, sous le coup de la chaleur et de verres en trop, ses cheveux, par un effet mécanique, se torsadent, s’enroulent, se bouclent. Un vrai phénomène. Plus il s’imbibe, plus il moutonne.
« Thomas m’a dit que tu t’intéresses aux situs ? C’est vrai, ce mensonge ?
La jeune femme avait presque oublié l’objet de sa visite.
– Thomas ne ment jamais ! Réplique-t-elle en sortant de son sac, très professionnelle, son magnéto.
Boreli et Federmann-Dutriez, imperceptiblement, se mettent en retrait. Le héros, leur héros, c’est Serge, à l’évidence. L’autre se fait désirer.
– Tu es sûre que ça va brancher tes lecteurs ? »
Elle insiste, il capitule.
Eté 66 : élection à l’Association des étudiants strasbourgeois, l’AFGES. D’ordinaire, ce vote est une formalité. Mais là, surprise : les « situs » raflent la mise. Six élus. Le scrutin est tout ce qu’il y a de plus démocratique. Certes, il n’y a guère de votants, mais les absents ont toujours tort, c’est bien connu. Un groupe totalement hors norme, s’empare de la direction et de tout ce qui va avec, restaurant, imprimerie, mutualité, centre de santé.
« On se fait la main en chassant quelques profs réacs à coups de tomates. On part en guerre contre la répression psychiatrique. On détourne la BD en instrument de propagande ».
Six mois durant, les situs vont agiter le landernau, flinguer « une société décadente », son « université ignorante », ses professeurs « crétins » et recommander de « jouir sans entrave ». Un programme d’une simplicité biblique, qui leur vaut pas mal d’ennemis. La presse locale s’étrangle contre ces « beatniks ».
« Notre grande œuvre, c’est un pamphlet, génial : « De la misère en milieu étudiant considéré sous ses aspects économique, politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens pour y remédier ». Tu en as entendu parler ?
Elle hésite, il enchaîne.
« Nos héros ? Tous ceux qui sentent alors le soufre aux quatre coins du monde. Les émeutiers de Watts, le quartier noir de Los Angeles ; le mouvement provo, d’Amsterdam ; les japonais de Zengakuren. Tous des énergiques, tu peux me croire. Nos textes prônent la révolte contre la marchandisation de la société. Là, ça te dit quelque chose ? »
Georges opine, sourie, rêvasse. Comme un vieux gamin qui voudrait qu’on lui rende sa jeunesse. Cesare intervient :
– Raconte le coup de la banque !
– Tu crois, minaude l’autre.
« Il y a prescription » tonne Cesare qui se charge alors de raconter. En ce temps-là, Serge et un comparse s’étaient mis en tête de faire un casse. Histoire de déposséder un peu les possédants et de se constituer un trésor de guerre. Repérage d’une petite banque des faubourgs, préparation du matériel, passage à l’acte. Pour laisser le moins de trace possible, ils ont décidé de ne pas parler une fois sur place, mais de glisser au caissier un petit mot, en alsacien, disant : « Attention ! C’est un hold-up ! Passez l’argent ! Vite ! ». Cagoulés, les deux intrépides investissent le lieu ; une seule cliente, genre institutrice bégueule, curieusement pas trop affolée devant cette arrivée de martiens. Ils déposent sur le guichet le mot, attendent. Est-ce qu’ils maîtrisaient mal le dialecte ? Ou le caissier était-il ce jour-là particulièrement limité des neurones ? Le fait est qu’il n’arrive pas à déchiffrer le message. Il bute sur chaque mot, ne comprend manifestement pas le charabia, annone : « Atten… atten… C’est un… c’est un… » Tout du même tonneau. S’il faisait l’andouille, c’était bien joué. Le plus probable, c’est que le texte était simplement mal écrit, aucun des deux intervenants ne connaissait vraiment l’alsacien. Le guichetier n’en finissait plus de bégayer, la vieille fille leur lançait des œillades atterrées. C’était interminable. Et eux qui avaient fait le vœu de silence ! Vexés, confus, ridicules, ils se consultent du regard et décident de battre en retraite !
Chef de bande, Serge s’empresse de reprendre la main et s’exalte :
« Il y avait un peu de folklore, si tu veux. Mais on était ambitieux. On voulait subvertir l’art, le réaliser dans la vie quotidienne.
– Et côté politique ?
– On prônait l’insurrection, la vraie ! Arrêter de survivre, politiser la délinquance, pratiquer le terrorisme burlesque, libérer les mœurs, changer les médias ! L’affaire prend une dimension nationale, la presse fait gros sur les chevelus d’Alsace. Ici, les bourgeois paniquent. Ils crient au fou ! Le recteur nous menace de l’asile. Puis l’autorité fait donner ses tribunaux. »
Noël 66 : fin de l’épopée. Déjà. Elle venait à peine de commencer.
« La procédure eut raison de la révolte. Les leaders situs ont été exclus de l’université.
– Et toi ?
– Moi, j’ai pu passer entre les mailles. Miraculeusement.
– Et surtout, conclut, péremptoire, Cesare, oubliant provisoirement ses fonctions, tous ces slogans vont être repris en grand par la France entière moins de deux ans plus tard . »
Cet effort de mémoire méritait bien une nouvelle tournée de Gewurtz 98.
Aigle faisait médecine. Il continua d’animer en sous-main une feuille radicale, « La taupe rouge » et mena à terme ses trop longues études. Il avait tout pour faire carrière, il aurait pu être au choix enseignant, chercheur, praticien mais, sans crier gare, un jour, il laissa tout tomber et partit.
« C’était quand déjà ?
– En 1976. »
Chaque fois qu’une année s’invite dans leur conversation, on sent ces vétérans happés par un souvenir. Ils ont besoin de mettre des repères sur les dates. Par peur du vide ? 1976, pour Boreli, c’est l’année de Ranucci, guillotiné aux Baumettes, Giscard d’Estaing avait refusé sa grâce. Federmann pense au dioxine de la catastrophe de Seveso. Serge, lui, rappelle que le tube, cette année là, était une chanson espagnole du film « Cria cuervos » de Carlos Saura.
« ?!
– Vous vous souvenez plus ? Elle était interprétée par Jeannette : « Porque te vas/ porque te vas/ porque te vaaaaaas »
– Parce que tu pars ? Ou pourquoi tu pars ? C’est vrai au fait, pourquoi tu pars, lui demande Véronique.
– Un coup de tête.
– Pour où ?
– Pour le Congo.
– Direct ? De Strasbourg au Congo ?
– Direct !
– C’était ton côté « Bon docteur Schweitzer » ?
– Si tu veux.
Ils se livrent encore au petit jeu du « Je me souviens » ( du premier tract, de la première A.G., de l’unique barricade…). Éméchés et rigolards, ils retrouvent leur chambre à une heure avancée.
Les portes n’ont pas de numéros mais sont identifiées par d’autres photos soixante-huitardes. Celle qui orne la chambre de Véronique dit : « Celui qui parle de révolution sans vouloir changer la vie quotidienne, celui-là a dans la bouche un cadavre »
En guise de bonsoir, elle lance à la cantonade :
« Au fait, personne ne me l’a demandé mais 1976, c’est mon année de naissance ! »
Boreli vient lui dire de ne pas s’étonner des cales sous le lit ou l’armoire. Il lui en reparlerait plus tard. Il s’attarde dans la chambre, semble attendre quelque chose ; elle le remercie, il bat en retraite, penaud.
Peu après, on gratte à sa porte. Federmann-Dutriez veut, dit-il, reparler de l’année 1976 ; il finit par accepter l’idée qu’il est aussi possible de faire ça le lendemain. On entend encore des bruits de pas, d’ablutions diverses, des slogans fredonnés dont elle ne retient pas les paroles. Puis c’est le calme. Enfin pas exactement. La paix de la maison est traversée de bruits bizarres, des petits crissements, de menus craquements, comme des torsions. La demeure semble souffrir, on dirait qu’elle se plaint. Boreli avait prévenu Véronique de ne pas s’inquiéter. N’empêche ! Il lui faut un petit moment pour s’y faire.
De longues minutes plus tard, elle sort, s’en va au bout du couloir et pousse la porte de la chambre de Serge, celle qui expose le cliché : « La folie est à l’ordre du jour » : l’homme, torse nu, accoudé à la fenêtre, contemple le néant. Il se retourne à peine ; elle va se coller contre lui ;
– Je savais que tu viendrais.
– Prétentieux !
Elle jette un œil sur le village. En vain.
– On voit rien !
– Ça vaut mieux.
– Pourquoi ?
– Tu verras…
– Décidément, c’est une manie chez vous ! Tout le monde n’arrête pas de me dire que je vais voir ! Et qu’est-ce que je dois voir ?
Il se taît. Elle l’entraîne au lit, le déshabille, l’allonge. Docile, il se laisse faire.
« Bel Africain…
– A vos ordres !
– Je n’ai pas encore de quoi faire un article vivant
– C’est à dire ?!
– Qu’il me faudrait des souvenirs supplémentaires, du vécu.
– Maintenant ?
– Maintenant !
6
STRASBOURG, été 1945
Blanc
J’ai pu reconstituer le calendrier du professeur Hirt de la mi-1942 à l’été suivant. Manifestement, il est très occupé. Il enseigne à l’Université ; il anatomise à l’Institut, où il initie ses élèves au travail d’autopsie en utilisant les corps de prisonniers russes morts de tuberculose ; et il crée, en juillet 1942, au Struthof, une « unité de recherche scientifique ».
Le camp, je l’ai dit, est étagé. Depuis la porte d’entrée, une double rangée de baraquements descend jusqu’à la lisière de la forêt. Les deux dernières baraques semblent identiques aux autres. Mais l’une est une prison car même au sein d’un camp de concentration, les nazis imposaient une prison ! Elle se compose de cellules collectives et de cachots individuels, minuscules, moins d’un mètre de côté, qui me font penser aux cages de fer de Louis XI dont on nous parlait à l’école. Les gens ont vite fait de s’y ankyloser et d’y périr dans d’atroces souffrances. Au centre de ce bâtiment, trône un chevalet sur lequel étaient bastonnés les prisonniers.
La baraque qui fait face possède en son centre un four crématoire, surmonté d’une interminable cheminée, que tous les prisonniers ont en permanence sous les yeux pour pouvoir se dire : « C’est là que je finirai ! ». August Hirt y a fait installer, dans une aile, sa salle d’expérimentation. Ce bloc opératoire est une pièce blanche, claire, aux sol et aux murs carrelés, aux fenêtres grillagées. Au centre trône une table d’opération imposante, bétonnée, pavée des mêmes carreaux de céramique ; le plateau en est légèrement incliné ; il est parcouru, sur sa longueur, de rigoles, comme les nervures d’une feuille où devaient couler le sang et les humeurs des sacrifiés. Elles convergent vers le pied de la table où se trouve un petit lavabo. C’est sur cette table qu’on manipulait, qu’on testait, qu’on charcutait. J’ai visité le lieu, je peux dire que j’ai rarement vu un endroit plus glaçant que cette chambre aux cobayes. J’imagine l’effroi qui devait saisir les êtres traînés dans ce monde blanc, un blanc brillant, aveuglant, froid, le blanc du passage, vers la mort, le vide, l’effacement, l’absence, un monde de linceul, de vampires et de spectres comme devaient leur apparaître les « docteurs » qui les prenaient en charge. Entrant dans ce monde d’une blancheur immaculée, éblouissante, comment ne pas avoir le pressentiment d’aller vers l’anéantissement ?
Au camp comme à l’Institut, August Hirt « travaille » avec deux autres médecins, les professeurs Eugen Haagen et Otto Bickenbach. Plus jeunes que lui, ces spécialistes sont des praticiens expérimentés et brillants. Tous les deux sont chefs de service à l’Université de médecine. Otto Bickenbach est directeur de l’Institut de recherches médicales. Son allure est plutôt débonnaire, très père de famille. Eugen Haagen dirige lui l’Institut bactériologique. Aryen exemplaire, mince, hiératique, il affiche la blondeur saxonne, des yeux bleu clair, un visage affûté. Sportif chevronné, il a coutume de voyager en moto, harnaché de cuir, entre Strasbourg et le Struthof. L’homme est réputé pour son élégance naturelle. Aux dires de Mlle Adler, il rencontre un vif succès auprès du personnel féminin. Beaucoup trop, à son goût. Je n’ai pas voulu lui demander s’il s’agissait de l’auteur de sa rondeur mais la confusion qu’elle manifeste chaque fois qu’il est question de ce professeur me semble la meilleure des réponses.
Le trio est entouré de jeunes doctorants allemands mais aussi d’assistants alsaciens ; j’ai pu notamment identifier un quarteron de collabos ambitieux et particulièrement actifs : Peter Kougelman, Walter Birmann, Rolf Birdof et Julius Hauser.
Qui fait quoi ? August Hirt expérimente l’ypérite, le fameux gaz moutarde, dont les nazis entendent probablement relancer la production. Eugen Haagen, épidémiologiste, teste le typhus, sous forme de vaccins, de scarification au bras. Otto Bickenbach s’est spécialisé sur le phosgène, un gaz incolore très toxique, obtenu par la combinaison du chlore et de l’oxyde de carbone.
Pour faciliter ces expérimentations, August Hirt va se faire construire une chambre à gaz rien que pour lui et ses sbires. Une chambre à gaz sur mesure, privée en quelque sorte. A quinze cent mètres du camp, à l’orée d’un bois, se trouve une auberge avec dépendance. Du temps où l‘endroit était encore une station de sport d’hiver couru, cette demeure était l’auberge de jeunesse favorite des strasbourgeois ; il devait faire bon s’y réfugier l’hiver, s’y mettre à son aise et s’y étourdir de vin chaud, ou l’été, se prélasser sur la terrasse pleine de rires et d’odeurs de résineux. La bâtisse qui fait face à l’auberge, de l’autre côté d’un petit chemin, était une remise pour les skis et le matériel. C’est là où le professeur Hirt installe sa chambre à gaz. La grange est partagée en quatre structures. Deux salles servent au déshabillage, une troisième pièce comporte trois cuves, profondes. La chambre proprement dite est un quadrilatère de 2,60 mètres de haut, 2,40 de large et 3,50 de profondeur. Les murs sont recouverts de carreaux de faïence blancs ; le sol est en ciment, goudronné ; le plafond est ripoliné et en son centre se trouve un plafonnier, grillagé ; la porte, puissante, est garnie à l’intérieur d’une plaque de tôle. Du feutre dans l’encadrement rend la fermeture parfaitement étanche. Trois verrous en assurent une clôture hermétique.
Dans la paroi gauche, quand vous êtes en face de la porte, une petite fenêtre rectangulaire, à double vitrage, est protégée par une grille. Elle permet, de l’extérieur, de voir comment les cobayes réagissent, combien de temps ils mettent pour agoniser, quels produits sont les plus performants, quelle quantité toxique est nécessaire pour les terrasser…Les toubibs disposent, non loin de ce regard, d’un commutateur électrique qui commande l’éclairage de la pièce, et d’un entonnoir, communiquant avec la chambre, où ils glissent leur poison.
Dans le mur opposé, ub clapet donne sur un ventilateur et la cheminée extérieure.
Alors qu’il est engagé dans ces travaux et tests divers, August Hirt est informé de la réponse de Heinrich Himmler à sa lettre. Mlle Adler se souvient de la précaution du commissionnaire lorsqu’il lui remit la missive. Le professeur s’attend à une réponse positive du chef de la Gestapo. N’empêche, l’accord, enthousiaste, de Berlin le fait bondir de joie. Il se met à entonner, selon sa secrétaire, « Wie sollten wir geheim sie halten ? Comment devions-nous tenir secrète ?", un air que l’on entend dans tout l’Institut :
Zu höherm Glanz und Dufte brechen
Die Knospen auf beim Glück der Zwei
Und süber rauscht es in den Bächen
Und reicher blüht und reicher glänzt der Mai
Et plus brillants et odorants éclosent
Les bourgeons, voyant le bonheur du couple
Et plus doux est le murmure des ruisseaux
Et plus riche l’éclat des fleurs de mai. »
Strauss, le délicat !
Selon Mlle Adler, cette bonne nouvelle est la bienvenue alors que des informations persistantes en provenance du front de l’Est font état d’une résistance imprévue des Russes. Les combats traînent du côté de Stalingrad.
Le Ministre de l’Intérieur du Reich se dit « prodigieusement intéressé » par le projet de constituer un musée des sous-races ; il trouve que le plan d’August Hirt va susciter un engouement « énorme » dans le pays ; il l’assure du soutien sans faille de la machinerie nazie pour mener à bien l’affaire. Il laisse au professeur ainsi qu’à Wolfram Sievers le soin de mettre au point le détail de l’opération et d’en assurer la gestion.
« Und reicher blüht und reicher glänzt der Mai » : August Hirt exulte. Comme première mesure, il charge un anthropologue et membre de la SS, Bruno Beger, de l’Université de Munich, de définir très précisément tous les critères des personnes recherchées, de manière à disposer d’une nomenclature parfaite de la sous-race des judéo-bolcheviks : âge, sexe, lieu de naissance, origine, profession, corpulence, taille. Une attention particulière est portée au crâne : August Hirt a de très longs débats, dit Mlle Adler, avec Bruno Beger pour s’accorder sur les références à retenir. Ils peuvent passer des heures à établir l’exacte nomenclature de la boîte osseuse, la forme des os, l’occipital, le sphénoïde, le temporal, le pariétal, le frontal, l’ethmoïde, et celle des os de la face ; ils discutent jusqu’à plus soif des dimensions du nez, des mâchoires, de la forme des yeux, de la dentition …
Comment mesurer, tester, réguler, apprécier, estimer, sonder, proportionner au mieux ces « stucks », ces « morceaux » de choix pour le futur musée ? C’est un travail considérable, qui prend du temps. Une responsabilité devant le Reich. On reconnaît là, mon commandant, la bureaucratie nazie, sa maniaquerie. Ces assassins ont une mentalité de chefs comptables. Avec leur coutumière minutie et la bonne conscience de travailler pour l’Histoire, ils entendent établir leur doctrine raciste sur des normes incontestées.
C’est à ce moment là qu’ August Hirt et Wolfram Sievers décident d’organiser autrement la récupération du « matériel » : plutôt que de s’imposer des transports périlleux de cadavres et de crânes à travers l’Europe, comme ils l’avaient d’abord imaginé, ils estiment finalement plus simple de véhiculer vivants ces commissaires juifs, depuis les camps de l’Est jusqu’à celui du Struthof et de les tuer sur place. La chambre à gaz récemment construite allait parfaitement répondre à cet objectif. Les services sont mis dans le secret. La S.S., l’association « L’héritage des ancêtres », le ministère de l’Intérieur, tous approuvent ; mieux, ils applaudissent cette simplification de la procédure.
En juin 1943, le SS Bruno Beger, accompagné, m’a-t-on dit, d’un « collègue » universitaire de Tubingen dont j’ignore le nom, se rend à Auschwitz ; avec ses fiches, ses instruments, ses croquis, ses règles, ses mensurations types, ses profils idéaux ; il est chargé de choisir 150 Commissaires.
Il séjourne dans le camp du 7 au 15 juin, très exactement. Bruno Beger va y faire son marché, comme un maquignon qui se rend à une foire aux bestiaux. Il fait défiler des centaines de détenus, les évalue l’un après l’autre puis opère un premier tri. Ensuite cet anthropologue pointilleux sort ses outils. Pas question de se laisser aller au subjectivisme, à l’à peu-près ; il faut procéder à une manière de bertillonnage pour identifier les « commissaires » dignes de figurer demain dans la collection du musée impérial. Visionnaire, il devine derrière chaque visage l’ossature qui donnera à voir cette race hideuse. Inquisiteur, il interroge ses proies, entend personnellement prendre leurs mensurations, de manière méthodique. Il toise, mètre, millimètre, sonde, calcule, dose. Il examine particulièrement la forme du crâne, du nez, de la bouche. Il photographie, face, profil. Il retient des hommes, des femmes, des jeunes gens, des vieillards. Tout cela prend du temps. Beger passe des journées entières à confectionner son fichier, engrange une masse de données, de mesures, de clichés, tout un luxe de détails scientifiques.
Une fois ciblés, ces « stucks » sont mis en quarantaine à Auschwitz même. Ils auraient été, dès lors, mieux nourris que le reste du camp, Bruno Beger ayant négocié, assez âprement semble-t-il, avec l’administration pour obtenir ce traitement de faveur. Ils seraient aussi, très relativement, préservés des coups. Ils sont sensés, en effet, passer à la postérité, il faut qu’ils présentent bien. Ces spécimen doivent avoir de l’allure.
Quel est l’identité de ces prisonniers ? Je l’ignore. Je connais simplement, grâce au seul document qu’on a pu retrouver ici sur l’affaire, leur pays d’origine. La moitié d’entre eux vient de Thessalonique.
Nous avions, à Montparnasse, dans notre groupe de peintres, un macédonien que tout le monde appelait Axios le byzantin. Discret et malicieux, il aimait nous parler de sa cité, de ses églises, ses basiliques et ses synagogues, vanter ses fresques et ses mosaïques. Il ne disait jamais Thessalonique mais il nommait sa ville « la capitale ». Capitale de quoi ? on ne savait pas au juste. J’ai perdu de vue Axios au début de la guerre…
Et voilà la communauté juive de cette ville, établie en Grèce depuis leur fuite d’Espagne en 1492, massivement choisie par des médecins hitlériens pour figurer « l’autre » dans leur musée de la sous-humanité.
Mais il y a aussi parmi eux des gens d’Europe centrale (Pologne, Ukraine, Tchécoslovaquie, Moldavie ), d’Allemagne, d’Autriche, des Norvégiens, des Néerlandais et un Français, venu de Drancy, dit-on.
Comment réagissent ces otages ? Comment interprètent-ils l’intérêt soudain qu’on leur porte ? Que pensent-ils des soins insolites dont ils sont tout à coup l’objet, de cette mise en fiche comme une espèce rare, comme des bêtes à part ? Que signifie pour eux ce changement de régime ? Comprennent-ils de quoi ils sont l’enjeu ? Ce qui n’a pas changé, c’est le regard du bourreau sur eux, le même indicible mépris, la même arrogance infinie. Avec, peut-être, en plus, un incommensurable cynisme. Mais pressentent-ils la manipulation ? Victimes abasourdis de tant de violences, et depuis si longtemps, pensent-ils que le pire est à venir ? Ou rendent-ils grâce à Dieu pour ce miraculeux traitement, pour cet allègement de peine inespéré ? Je suis bien incapable de répondre à ces questions mais elles me torturent avec application.
Un beau jour, je ne sais plus qui m’a dit ça, Bruno Beger se décide à hâter le mouvement et abrège sa mission. Pourquoi ? Par scrupule ? Des témoins laissent entendre qu’il est attentif à ne pas laisser trop de traces de son passage. Ou s’est-il heurté aux réticences des tueurs d’Auschwitz, hésitants à lâcher leurs proies ? On peut aussi penser que sa précipitation a une raison triviale : garder en forme, toute relative, des dizaines de détenus en ce lieu, coûte. Une banale histoire d’intendance aurait donc pu expliquer son empressement. Le fait est qu’au lieu des 150 cobayes souhaités, le « matériel » se chiffre finalement à 87 personnes, 30 femmes et 57 hommes. L’anthropologue fait savoir à August Hirt qu’il a « réuni le matériel ». Le professeur se pâme ( « Und reicher blüht und reicher glänzt der Mai »), trépigne et le presse de rentrer. Avec ses « stucks ».
7
Samedi 14 mai
10hoo
Véronique est réveillée par une sorte de grondement. C’est comme un remuement venu des entrailles de la terre, un borborygme tellurique.
Le temps de se réadapter, comme si elle passait par un sas, pour oublier Paris, le boulot, le journal, elle cherche ses marques. Elle reconnaît le lit de « l’Africain », la place vide de son amant. Puis elle remarque que tous les meubles ici aussi sont sur cales, des cales imposantes parfois, jusqu’à 10 centimètres. Sous ses pieds, le carrelage a travaillé, il s’est soulevé par endroits et brisé en mille morceaux. Le sol est en pente, comme le pont incliné d’un bateau. Pas au point d’en attraper le mal de mer, mais enfin… Elle devait être trop émue cette nuit pour réaliser que la maison était de traviole.
Intriguée, elle va à la fenêtre. Là, une grimace incrédule apparaît sur son visage. Hier soir elle pensait bien être à Strasbourg, ou presque, disons dans ses faubourgs. Et voilà qu’elle se reveillait dans le Bronx, à Beyrouth, à Grozny. Au choix. Des restes de brouillard en effet émerge un paysage de guerre.
Cesare, l’air fripé, les cheveux en bataille, est assis sur le pas de la porte. Il la regarde. Il l’attendait ?
« Étonnant, non ?
Médusée, elle dodeline de la tête.
– On ne s’habitue jamais, ajoute le flic.
La veille, il était trop tard, il faisait trop sombre. Elle n’avait rien vu. Le café « Jérusalem » est à l’entrée du bourg. Légèrement surélevé, il est le premier bâtiment d’une rue qui fut longtemps la rue principale ; ce devait être l’artère des commerces, des manifestations, des cérémonies religieuses, des défilés du 14 juillet, de la fête foraine.
Aujourd’hui la rue Novembre est balafrée, l’asphalte éclatée, la chaussée fissurée, comme écartelée. De part et d’autre de la route, tout est dévasté ou presque. Sur les trottoirs, soulevés, courent des barrières de protection, histoire de dire : Défense d’entrer ! Alternent maisons affaissées et espaces nus, où ne restent que des gravats, là où le bâtiment a été rasé. Une maison sur deux à peu près a disparu. La rue a l’air d’une dentition pourrie où alterneraient trous et vieux chicots. Les pavillons qui tiennent encore ressemblent à ces bateaux sur cales, pour le grand carénage. Ils ne se maintiennent qu’à l’aide d’étais en bois, se redressent avec des vérins hydrauliques.
Véronique descend dans la grande salle, retrouve au bar Aigle et Federmann-Dutriez. Déguisés en garçons de café, un tablier à la taille, ils briquent des coupes, des fluttes, des chopes même, frottent, astiquent, inspectent, le bras tendu vers la lumière, la brillance de leurs verres. De vrais pros du zinc. A croire qu’ils ont fait ça toute leur vie.
Ils semblent s’amuser de l’effroi de la jeune fille.
« La première fois, ça fait toujours ça » commente Georges.
Elle rejoint le flic sur la placette.
En silence, ils s’engagent dans la rue, prudemment.
Les maisons font peine à voir, avec les murs crevassés, les escaliers désolidarisés du bâtiment, les encadrements de portes ou de fenêtres désaxés, les battants sortant de leurs gonds et calés vaille que vaille. Elles semblent sur le point de basculer, de chavirer. Les garages sont lézardés. Les jardins sont en friche, les haies ne sont plus taillées, les plantes grimpantes retournent à l’état sauvage, les arbres ébouriffés paraissent hostiles.
Par endroit, le sol s’est enfoncé de plus d’un mètre. Pourtant deux ou trois résidences semblent encore habitées. Apparemment, elles portent moins de stigmates, à peine une ou deux rides au coin des fenêtres mais on sent bien que ce n’est que partie remise. Des sursitaires. Véronique parcourt des yeux ce chemin de croix. Tout est de guingois.
« La maison des parents !
Cesare désigne une surface vide, à droite du Jérusalem.
« Je t’épargne les questions inutiles. C’est pas la guerre, c’est pas le terrorisme, c’est pas un typhon ni une descente des mômes de banlieues...
– ?!
– C’est la mine !
– Mais encore ?
– Rodinger est une cité minière qui sombre comme tant d’autres dans le chaos depuis que la mine est partie.
Un silence. Puis le flic se fait sentencieux :
« Le passé fait de nous table rase. »
Guide de ce champ de ruines, Cesare ajoute qu’une fois l’exploitation du sous-sol arrêtée, La Mine a laissé les choses en plan. L’eau s’est infiltrée dans les galeries. Petit à petit, elles ont été « ennoyées ». Certaines étaient larges de cent cinquante mètres, hautes de quatre, longues de plusieurs kilomètres. « De vraies cathédrales souterraines ! » Elles se sont peu à peu effondrées ; le sol s’est dérobé, emportant avec lui les maisons.
« Chaque fois que je passe ici, je suis entre nostalgie et amertume. Je me demande si j’ai bien fait de venir, j’éprouve une violente envie de fuir. »
Il soupire puis se fait l’avocat du diable :
« Tu sais, ça n’a pas toujours été comme ça. J’ai des souvenirs splendides de ce coin. Des hivers grandioses ornant les vitres de dentelle de givre. Des étés de canicule où des alouettes bavardes survolaient des champs de luzerne. Je me souviens d’une infinité d’odeurs, celle du caveau de mine, mélange de rouille, de résine, de goudron ; celle des prés après la pluie, du foin juste coupé ; celle des mansardes surchauffées... Il y avait des haies drues qui séparaient les champs : on y aménageait des espaces de jeu, grotte d’Ali-Baba, caverne de pirates, campement indien. Je me souviens aussi du garde suisse à l’Eglise, bicorne à panache, rédingote sombre à épaulettes dorées, plastron immaculée, épée en bandouillère, large canne à pommeau d’ivoire. Et puis des permissionnaires qui paradaient, en uniforme, sur cette rue précisément : ils étaient beaux, gais, souriants ; ils allaient repartir en Algérie. Je me souviens encore du premier « rouge » rencontré au village, il s’appelait Mr Blanc, sans blague. »
Cesare cesse sa confession aussi brusquement qu’il l’a commencée. Ils s’assoient sur un muret renversé. Véronique se dit qu’ils ont l’air à peu près aussi dévasté que le décor. Elle redoute cette sinistrose, elle a peur de s’y enliser. Volontaire, elle attaque :
– J’ai rêvé de toi cette nuit.
– Trop aimable.
– Enfin, de ton enquête. C’était un rêve peuplé d’hommes rouges, de voyeurs, de morts…
– Désolé… Tu… tu veux tout de même connaître la suite ?
– La suite ?
– Le troisième meurtre ?
Le visage du flic s’anime à nouveau. Sans attendre la réponse de la jeune femme, il reprend le fil de son récit.
Il avait été appelé à l’université de médecine ; c’était l’an dernier donc, au printemps. Un administratif l’attendait non loin du grand amphithéâtre d’anatomie et le conduisit à une vaste salle en sous sol où l’on entreposait le matériel servant aux cours et aux travaux pratiques. Boreli, blindé, s’amusa plutôt à la vue de cette armada de squelettes articulés, ces alignements de carcasses de cire, de plastique, de bois, ces entassement d’ossements, cet amoncellement de membres, de têtes, de troncs artificiels, de bustes plastifiés avec vue sur leur intimité, d’organes disséqués, de tissus conservés, de corps écorchés, dépouillés, dépiautés, exhibant artères et veines, de maquettes montrant qui leurs muscles, qui leurs nerfs, qui leurs viscères. Il eut l’impression de passer en revue une armée de figurants tout droit sortis d’un film de Roméro. Il fallut traverser l’immense ossuaire avant d’arriver à un couloir étroit et sombre qui flanquait la salle et se perdait dans les entrailles de la faculté. L’endroit, sillonné par d’énormes canalisations, était étouffant. Ça devait être bourré d’amiante, se dit le flic.
On lui désigna dans le mur, à la hauteur du sol, un casier qui ne devait guère faire plus de soixante centimètres de côté, dont la petite porte métallique était béante. Un paquet, chiffonné, trônait devant cet espace vide.
La cavité servait d’ordinaire à stocker une bobonne de gaz. Ce matériel pouvait dépanner lors d’expériences en salle de chimie mais ces derniers temps, on en avait moins l’usage.
Dans ce coin peu passant, c’est le moins qu’on puisse dire, personne ne s’était étonné ces derniers mois de voir la bouteille traîner devant sa niche. Un jour, durant l’été, à l’occasion d’une réfection générale du bâtiment, des ouvriers voulurent en ouvrir le battant ; il était fermé avec un cadenas. Personne n’en possédait la clé, il fallut le faire sauter. L’abri était occupé. Les gens de l’entretien ne réalisèrent pas tout de suite ce qui l’encombrait, une masse bouchonnée. A leur décharge, et même s’ils étaient habitués aux figurants incongrus de la réserve voisine d’anatomie, ils ne s’attendaient guère à trouver un homme en état de momification avancée.
On avait eu du mal à l’extraire de son renfoncement ; et surtout on n’avait pas réussi à le déplier. Le corps avait pris en quelque sorte la forme du moule qui l’emprisonnait. Comme sous l’effet d’une transmutation. C’était un mort cubique, une première pour Boreli. Il formait un parallélépipède tout sec, présentant six faces carrées à peu près égales.
« Un hexaèdre » souffla un flic stagiaire qui accompagnait le capitaine ce jour là. Boreli comprit avec un temps de retard que l’autre lui parlait de géométrie.
« C’est pas le moment » fit-il.
Replié, solidifié, le mort était comme un dé monstrueux jeté par un joueur maléfique.
Le cadavre ne fut pas trop difficile à identifier. Il portait ses habits de ville. Ses papiers disaient qu’il s’agissait du professeur Hauser, Julius Hauser. L’intrus était une ancienne gloire de l’anatomie qui venait, malgré un âge canonique, hanter les couloirs de la faculté ; personne n’osait le dissuader, on le laissait errer ; c’était sa promenade, son rite.
Il faisait partie du décor, en quelque sorte, on le voyait sans le voir. Quand il avait disparu de son domicile au printemps dernier, un voisin avait bien alerté la police mais celle-ci ne put que constater l’évaporation du professeur. Cet ancien élu municipal éphémère d’un mouvement d’extrême droite était parti sans laisser d’adresse. La dernière fois qu’il avait été vu, c’était à l’université, mais personne n’était en état de dire quand, où, comment… Bref le papy fut porté au rayon des disparus…
Difficile de penser que le papy s’était glissé tout seul dans sa cache... Pour Boreli, le bonhomme, sans doute suivi lors de sa dernière pérégrination dans la Faculté, avait du se faire surprendre dans la remise aux squelettes, ou avait été attiré là par un stratagème puis traîné dans le couloir mitoyen, tabassé, poussé, enfoncé dans la niche. Même avec un vieillard, il avait fallu à son agresseur une belle énergie pour l’enfouir dans ce minuscule cagibis. On avait dû l’y faire entrer à coups de poings et de pieds…avant de cadenasser sa geôle. Il pouvait toujours tambouriner, gueuler tout son saoul, il ne risquait pas d’attirer l’attention. Si de surcroît, il s’était fait piéger un week-end ou durant des vacances, il avait peu de chance d’avoir de la visite.
Il était mort de faim, de soif, de fatigue, de courbature, ou de peur, tout simplement. Ou de tout cela à la fois
Averti par l’exemple de Birmann, Boreli se doutait bien que Hauser avait du lui aussi collaborer à l’Institut du temps de l’annexion allemande. Il demanda à l’Université de médecine l’organigramme complet de leur administration pendant la guerre. On lui répondit que les archives étaient en voie de réaménagement et que sa recherche allait prendre du temps. Il en prit acte. Une fois encore, il ne lui fut pas difficile de faire oublier l’incident. On était à quelques jours du deuxième tour de la présidentielle. « Travailler plus » d’un côté, l’ « ordre juste » de l’autre. Le public allèché en oubliait même son goût pervers pour les beaux assassinats. Personne ne se soucia de la cubique dépouille.
Pour le reste, l’enquête était plutôt stationnaire.
Des bruits de motos tirent Véronique et Cesare de leur face à face.
« Je suis de cuisine ! Réagit le flic. Faut y aller. »
Ils s’en retournent au café devant lequel stationnent deux engins, immatriculés en Allemagne. Des clients ? « Une première ! » Sourit-elle.
Les barmen ne semblent pas partager son triomphalisme. Leurs premiers consommateurs les laissent plutôt perplexes. Dans la salle, les motards, un homme, une femme, cannette de bière à la main, font le tour de l’expo photo, hésitants. Ils sont de la même tribu mais de gabarit différent. Tous deux portent une combinaison de cuir, largement ouverte sur la poitrine, laissant voir un tee-shirt clair où l’on peut lire Wotan’s club, et un casque court ressemblant plutôt à une calotte. Mais lui est un géant, ventru, barbu ; il se déplace avec les bras boudinés écartés de part et d’autre du corps, comme pour tenir en équilibre ou comme un haltérophile qui vient de lâcher sa barre. La fille est menue, fragile, incertaine ; elle a gardé sur le front de petites lunettes étroites, qu’on utilise plus volontiers pour la plongée ; ça lui donne un air de coléoptère.
Wotan’s club… Véronique tilte. Elle a naguère participé à un dossier de sa revue sur le tatouage. Elle s’était occupée des gothiques et avait interrogé un agent de sécurité qui s’était fait dessiner un Wotan sur son bras. Comme elle s’étonnait de ce choix, le type l’avait fièrement rencardé. Un vrai puit de science. On ne pouvait plus l’arrêter. Wotan : dieu germanique, personnage insatiable, qui a besoin de toujours plus de guerre, de force, de femmes, de jouissance ; une créature excessive, grande gueule, un tyran, qui s’impose partout et sur tous.
Le tatoué alignait son savoir avec gourmandise. Plutôt rachitique, il cadrait mal pourtant avec son héros. Le barbu de la moto, lui, a plus le physique de l’emploi.
Véronique sourit. L’autre voit son regard, demande dans un français haché :
– Il y a un problème ?
Elle ne va pas se fâcher avec le premier client. Ce serait un comble. Ça fait des années qu’on l’attend finalement, un jour par an c’est vrai, mais tout de même, un consommateur, au « Jérusalem », c’est un événement. Elle ne répond pas à l’interpellation du viking et rejoint Boreli à ses fourneaux. C’est l’heure des spaghettis carbonara, son plat fétiche. Il lui a promis de lui apprendre la recette.
« Plus simple, tu meurs ».
La cuisine donne, par une large ouverture servant à passer les plats, dans la salle. Le couple de motards continue d’inspecter, longuement, l’expo ; il commente une affiche de 68, estampillée « Atelier populaire des Beaux Arts ». Celle du CRS casqué, lunetté, la matraque haute et le bouclier en avant, sur lequel on lit : SS. Les clients s’exclament, ricanent, parlent fort, comme s’ils étaient seuls.
Boreli s’applique déjà à découper une poitrine fumée en dés, à les faire revenir, dorés, à la poêle, à jouer le pédagogue mais le cœur n’y est pas. Il manque de se couper un doigt à force de suivre en même temps la déambulation des motards.
« Tu mélanges des jaunes d’œuf, du parmesan, de la crème fraîche et tes lardons ».
Il prépare ses pâtes, al dente, les égoutte, les glisse sur un plat, verse la sauce sur les pâtes chaudes.
« L’important, c’est de faire chauffer le tout à feu très doux, une minute. Pas plus. Pour que la sauce épaississe. »
Véronique a aussi du mal à suivre. Elle mate les Allemands. Ceux-ci reviennent brusquement au bar où Aigle et Federmann-Dutriez font mine de ranger les bouteilles. La fille interpelle l’humanitaire :
« Qu’est-ce qu’il fait, le Français ?
Serge grimace, passe un coup de torchon sur le zinc, se taît. La fille reprend :
– Z’êtes nouveau ici ?
– Et vous ? Réplique du tac au tac le barman, s’étonnant lui-même de sa réponse.
– Ich, Allemagne ! Grogne le gros qui décide que l’échange a assez duré ; il jette un billet sur le comptoir et s’éclipse avec la demi-portion.
La pétarade des machines va decrescendo alors que les barmen et les cuisiniers se regardent, dubitatifs.
8
Strasbourg, été 1945
Vert
Après un dernier contrôle policier, les 87 sortent d’Auschwitz fin juillet 1943. Ils croisent sans doute, le jour de leur départ, des convois de nouveaux arrivants. Peut-être même empruntent-ils un des ces wagons tout juste libéré de sa cargaison. Pour certains d’entre eux, il doit y avoir comme un air sinon de libération, du moins de trêve, de pause, de répit. Ou de miracle. Sortir d’Auschwitz vivants est proprement insensé.
Leur train file vers l’ouest, Dresde, Nuremberg, Stuttgart, Karlsruhe, Strasbourg. Certains d’entre eux avaient emprunté le chemin inverse quelques semaines plus tôt. Trois jours et trois nuits de transport sont nécessaires pour atteindre la petite gare de Rothau, sur le versant alsacien des Vosges. Il y a dans le groupe des Allemands, un Français. Il ont pu repérer des panneaux, des indications de lieu, des noms de ville, renseigner les autres. Mais tous doivent partager une immense perplexité. La douceur des Vosges les surprend, les intrigue. On est au mitan de l’été, dans ce passage privilégié de juillet à août. Le matin de leur arrivée, il fait déjà chaud à Rothau. Le village est typique de la vallée de la Bruche avec ses fermettes aux façades colorées, à la charpente apparente, aux larges fenêtres qui ruissellent de fleurs aux couleurs vives. Le coin est calme, trop peut-être. Pas âme qui vive dans les rues. La consigne en effet est donnée aux habitants, quand passent les convois de prisonniers, de ne pas se montrer, de ne pas voir non plus, de fermer portes et fenêtres ; on imagine des conversations qui se figent, des mouvements gênés dans le bureau de poste, tout à côté de la gare, des gestes furtifs derrière les rideaux, des regards volés dans les entrebaillements de portes.
A la descente du train, la colonne des 87, encadrée de SS, ne s’attarde pas ; elle quitte, rapidement, le village pour rejoindre à pied le Struthof. J’a tenu, mon commandant, à emprunter moi-même ce chemin le mois dernier. Il s’agit d’une marche d’une petite dizaine de kilomètres sur une route zigzagante et pentue. Le lent et monotone piétinement de la cohorte, les vociférations des soldats, toutefois tenus à ne pas trop frapper, ne parviennent pas vraiment à gâcher l’ambiance de calme, presque de sérénité qui se dégage du lieu. Une sorte de paix fragile commence à contaminer ces nomades. L’air est saturée d’odeurs, de foin coupé, de résine, de sapins. Après avoir dépassé une scierie, à la sortie du bourg, la route grimpe aussitôt. A mesure que l’on monte, il fait un peu plus frais. Le ravin, masqué par les arbres, se trouve alternativement à droite, à gauche et ainsi de suite selon les méandres de l’itinéraire à flanc de montagne. Par moments, le paysage se dégage, le panorama prend de l’ ampleur.
Le temps de la montée, les 87 s’abandonnent secrètement à ce havre végétal, à cette parenthèse verte. Le vert rassure, le vert rafraîchit, le vert est une couleur humaine, le vert est espérance, le vert est tiède, couleur de l’immortalité ; j’apprenais même à mes élèves que le vert exprime le retour à la mère. La colonne côtoie un monde enveloppant, protecteur.
Mais le vert peut être aussi vert de mort, le vert maléfique du pourrissement. Le vert-de-gris. L’émeraude est pierre du pape mais aussi de Lucifer.
D’ailleurs, après deux heures de marche, le chemin bifurque. Sur la gauche, en contrebas de la route, comme s’ils marquent une frontière invisible, l’auberge et sa dépendance, local désormais investi par August Hirt pour en faire sa chambre de mort, sont bien cachés au regard des passants. A droite, perpendiculaire à la chaussée, une saillie dans la forêt grimpe tout droit à travers un sous-bois ténébreux. Au terme de cette ultime montée, escarpée, on devine une clairière. Le groupe tombe sur une « datcha », avec piscine. C’est la résidence du chef du camp, le Hautsturmfuhrer (capitaine) Josef Kramer. Ce personnage va jouer un rôle important dans notre drame. Au royaume des salauds, il appartiendrait à la garde rapprochée du prince. Il a le profil type des carriéristes SS : ancien comptable, il a gravi les échelons de la hiérarchie de l’ordre noir dans la ferveur et le crime.
Une fois passée la bâtisse, des aboiements furieux de chiens loups signalent à la colonne qu’elle est de retour dans un monde trop connu d’elle ! Le Struthof occupe une vaste pente dégagée, délimitée par une double rangée de barbelés, elle-même ponctuée par des miradors trapus. Des dizaines de baraquements noirs s’égrènent pour former une sorte d’immense amphithéâtre. A l’horizon, de l’autre côté de la vallée, les sommets disparaissent derrière une brume de chaleur. Le groupe passe la porte d’entrée, en rondins, contourne des chicanes et accède à une terrasse où les accueille une potence.
L’instrument de supplice surplombe le camp. Les jours où ça lui chantait, m’a t-on raconté, le Hautsturmfuhrer organisait des pendaisons publiques. Les milliers de détenus étaient tenus de s’assembler sur les places qui se succédaient le long du grand escalier de pierre central, et d’assister au spectacle. Le chef du camp pouvait choisir une mort rapide du supplicié, avec ouverture de la trappe, chute du corps, nuque brisée, ou une mort lente : la corde se resserrait lentement sur le cou, le malheureux cherchait à reprendre pied, l’agonie durait.
Ces pendaisons donnaient lieu à des mises en scène diaboliques.
Les nuits d’hiver, les projecteurs des miradors balayaient le camp enneigé et venteux, parcourait le moutonnement des têtes des prisonniers alignés, frigorifiés, muets, qui remontait jusqu’à la plate-forme supérieure. Là, des officiers SS, en grand uniforme, la botte briquée, fumant le cigare, tournaient, arrogants et braillards, autour de la potence où le sacrifié entrait dans la mort. Les aboiements des chiens-loups accompagnaient ces messes noires.
Ce matin d’août 1943, quand arrivent les 87, les prisonniers du Struthof sont partis en commandos dans une carrière proche, une exploitation de granit appartenant à la société « Deutsche Erd und Steinwerke » de Berlin : l’entreprise avait trouvé là des esclaves idoines. Les seuls visages que la colonne croise sont ceux de malades qui ont pu échapper à la corvée ; ils sont hagards, décharnés, absents.
Les otages sont installés dans un bâtiment qui leur est réservé. Les deux ou trois semaines où il séjourneront là, ils resteront donc à l’écart des autres détenus.
Sur place, alors, seul le professeur Haagen officie. Assisté de ses habituels collaborateurs, il procédait à une série de vaccins, inoculant le typhus à des tziganes. Pour voir. August Hirt était retenu à Strasbourg. Mais il est averti par Josef Kramer que « le matériel », comme prévu, a bien été réceptionné. Le mandarin voit son plan prendre forme ; il exulte. Sa voix de stentor résonne dans les couloirs de l’Université :
Ach Lieb, ich muss nun scheiden
Gehn über Berg und Tal
Die Erlen und die Weiden
Die weinen allzumal
Hélas, amour, je dois te quitter
Passer par monts et vallées
Les aulnes et les saules
Tous pleurent à la fois
A présent, il s’agit de préparer les « stucks », autrement dit réussir la mise à mort des 87 et assurer leur transport jusqu’à la faculté. Le professeur Hirt se charge d’initier Josef Kramer à cette mission. Le toubib lui donne le mode d’emploi de la chambre à gaz. Le patron du camp dispose des sels cyanhydriques. Il connaît la dose nécessaire pour traiter chaque groupe, vingt à trente personnes à la fois. Quand les prisonniers seront enfermés dans la chambre, il devra verser le sel par une embouchure extérieure réalisée à cet effet. Ce sel glissera jusqu’à une cavité, sur le sol de la chambre, emplie d’eau. Au contact du liquide, il dégagera son gaz mortel.
Kramer commence par gazer les femmes, le 14 août 1943.
« Elles vont tomber comme des mouches » lui avait dit August Hirt au téléphone. On est en fin de journée, vers vingt et une heure, il doit faire exceptionnellement doux. Les victimes viennent de dîner, enfin si l’on peut appeler ça un dîner. Elles ont partagé des épluchures de pommes de terre pour l’essentiel. On les sépare du groupe. Elles sont conduites dans un camion bâché, à l’abri des regards, depuis le camp jusqu’à la chambre à gaz, un peu plus bas, distante d’un petit kilomètre, je l’ai dit.
Ici, je dois me féliciter, mon commandant, de notre coopération avec les services britanniques. Ceux-ci en effet viennent d’arrêter il y a peu en Allemagne l’ancien chef du Struthof. Informés de mon enquête, ils ont bien voulu m’adresser un double de leurs interrogatoires du Hautsturmfurher. Ce dernier reconnaît ses crimes et, évoquant notamment cette soirée du 15 août 1943, il indique que les femmes sacrifiées ne furent pas dupes de ce transport :
« Je leur déclarai qu’elles devaient passer dans la chambre à désinfection et je leur cachai qu’elles devaient être asphyxiées. Assisté de quelques SS, je les fis complètement déshabiller et je les poussai dans la chambre à gaz lorsqu’elles étaient toutes nues. Au moment où je fermai la porte, elles se mirent à hurler. »
Ces cris durent être suffisamment forts pour être entendu dans les environs. Je dispose en effet du témoignage d’un paysan, alors occupé à ramasser les foins, et dont la ferme, isolée, n’est pas très loin du bâtiment de la chambre à gaz ; il m’a dit garder le souvenir, ce soir du 14 août 1943, « de cris de femmes, des cris terribles, brefs ». Il me parlait avec un sourire gêné ; il ajouta être aussitôt rentré chez lui et s’être mis au lit. Je ne sais pas s’il a fait des cauchemars, cette nuit là.
Josef Kramer, technicien de la mort, explicite ainsi aux Anglais sa méthode :
« Je plaçai une certaine quantité de sel dans un entonnoir placé au dessus de la fenêtre d’observation. »
Le sel dans l’eau produit des émanations étouffantes :
« (…) J’allumai la lumière à l’intérieur de la chambre à l’aide d’un commutateur (..) et j’observai par le regard extérieur ce qui se passait à l’intérieur de la chambre. Je pus constater que ces femmes continuaient à respirer environ une demi minute puis elles tombèrent à terre. »
Au plus profond de leur détresse, ces femmes croisent donc le regard du capitaine Kramer, l’œil du diable, collé au viseur, Lucifer témoin de leur fin.
« Quand j’ouvris la porte après avoir fait fonctionner la ventilation, elles gisaient à terre, sans vie, pleines d’excréments. »
Ces premiers corps sont entassés sur un camion et livrés dans la nuit à l’Institut d’anatomie de Strasbourg où ils arrivent vers sept heure du matin.
A l’Institut, le professeur Hirt avait pris ses dispositions afin que tout soit prêt pour recevoir et conserver les cadavres. La chambre 11, dans les sous-sols, avait été réservée aux dépouilles des 87. Les SS du camp étaient venus aider le personnel, notamment les assistants-préparateurs alsaciens et les « garçons de salle » comme on les appelait ; ensemble, ils avaient aménagé dans cette chambre six grandes cuves que l’on va remplir d’alcool synthétique à 55°.
Ce 15 août, à l’aube, un inhabituel remue-ménage anime donc le campus. August Hirt est là. Les appariteurs mobilisés réceptionnent les corps, traînés dans les couloirs puis immergés dans les cuves. Auparavant des toubibs effectuent sur chacun d’eux une incision pour y injecter un liquide conservateur.
Un témoin du transfert a pu me décrire ainsi la scène :
« Lors de leur déchargement, les cadavres (…) portaient un matricule tatoué sur le bras ; ils comprenaient trente femmes de tous âges ».
Le même dira encore :
« Les corps sont arrivés pas encore rigides ; ils étaient encore chauds ; les yeux étaient encore grand ouverts et brillants ; ils sortaient des orbites, rouges et congestionnés ; en outre des traces de sang se voyaient autour du nez et de la bouche ; j’estimai que ces victimes avaient été empoisonnées ou asphyxiées ».
Hirt mesure-t-il l’ampleur de son forfait ? Le fait est qu’il conseille à ses collaborateurs de se taire sur ce qu’ils viennent de voir. « Si tu ne fermes pas ta gueule, tu subiras le même sort » aurait-il dit à l’un d’eux. Il est possible que ce témoin ait inventé cet échange pour se dédouaner aujourd’hui de sa responsabilité. Mais le secret, il faut le reconnaître, a été bien gardé. Dans son ensemble, le personnel de l’Institut s’est montré complice.
En même temps, le patron de l’Institut est trop content de lui pour être vraiment menaçant. On l’a vu, ce jour-là, rejoindre son bureau en entonnant sa traditionnelle Ständchen (sérénade) :
Mit Tritten wie Tritte der Elfen so sacht
Um über die Blumen zu hüpfen
Flieg leicht hinaus in die Mondscheinnacht
Zu mir in den Garten zu schüpfen
Avec des pas aussi souples que ceux des elfes
Sautillant au-dessus des fleurs
Envole-toi légère dans la nuit lumineuse
Pour te glisser au jardin près de moi
Viendra ensuite le tour des hommes. Jusqu’au 21 août 1943, l’opération gazage – transport – immersion va se répéter trois fois, selon un rituel inchangé. Hirt assiste alors à toutes les étapes ; il ne veut rien perdre du spectacle.
Gazées, les victimes sont à leur tour entassées dans un camion, conduites, nuitamment, à l’Université strasbourgeoise, et stockées au fil de leurs arrivages dans les cuves.
Au total, ces martyrs sont au nombre de 86 . L’un des hommes, en effet, devinant le sort qui lui était réservé, refusa d’entrer dans la chambre à gaz. Il y eut bataille, échange de coups. Finalement il est abattu d’une rafale de mitraillette. Un « stuck » de moins pour les toubibs : son corps est détérioré, son visage défiguré, il n’est plus bon pour la collection ; il va disparaître dans le four du camp.
Josef Kramer confie à ses juges anglais :
« Je n’ai ressenti aucune émotion en accomplissant ces actes car j’avais reçu l’ordre d’exécuter ces 80 détenus de la façon que je vous ai exposée. » Et puis, l’air de rien, il ajoute cette phrase terrible : « De toute façon j’ai été élevé ainsi. »
August Hirt, lui, est ému. Non par le carnage mais par sa propre réussite. Son projet prend forme, il a l’impression d’avoir bien travaillé. Trop travaillé même. Il se sent soudainement surmené et estime avoir mérité un juste repos. Qu’il prend sur le champ. Il part plus d’un mois au Tyrol. Du côté de Lienz. On a beau être en guerre et, derrière une blouse blanche, exercer le métier de bourreau, les vacances, c’est sacré ! J’ai retrouvé de lui une lettre adressée à son comparse Wolfram Sievers, datée du 24 septembre 1943. Il le remercie pour « son travail à la fantastique issue » et il ajoute :
« Bien que j’eusse passé ma première semaine en étant alité, les trois semaines et demi suivantes ont suffi à renflouer ma carcasse de vingt livres. Tout un chacun ici a tenu cela pour miraculeux ».
9
Samedi 14 mai
15h
C’est au tour de Federmann-Dutriez d’assurer la permanence au bar.
Seul client, un vieil homme, attablé près de la porte, répète, comme une antienne :
« Y a pas de passé, c’est toujours aujourd’hui ».
Serge invite Véronique à faire un tour. Ils évitent la rue principale, pas question d’attraper le bourdon, et se dirigent vers le terrain de football, à l’orée du village. Sans y prêter attention, ils passent devant une fourgonnette de la gendarmerie, en embuscade dans un chemin de traverse.
« Tu as de quoi faire un article, maintenant ? Demande l’humanitaire.
Elle sourit et ne reprend pas le sujet. Il parle de ses déboires avec la communauté française au Congo, de la mentalité de colons de ces résidants ; même les meilleurs d’entre eux n’échappaient pas au syndrome du paternalisme, ce qui le mettait hors de lui.
– Toi, hors de toi ? Tu sembles pourtant si assumé ?
– Ça m’arrive…Il paraît que ces moments-là, je ne suis pas beau à voir…
– Arrête, tu me fais peur !
Il évoque ses engueulades avec l’ambassadeur, un ancien apparatchik socialiste devenu expert en manipulation des notables locaux.
A l’horizon, au sommet de la longue côte qu’emprunte alors la route, apparaissent deux motards. Les promeneurs ont vite fait de reconnaître les estafettes du matin. A petite vitesse, le duo passe devant eux, sans les voir vraiment, se dirige jusqu’au « Jérusalem » où il prend paresseusement un ample virage et revient sur ses pas pour disparaître d’où il était venu. On entend alors un grondement diffus, un bruit sourd, persistant comme un très lointain orage, ou un interminable éboulement. Les deux émissaires réapparaissent suivi par dix, vingt machines. Bientôt, c’est un mur de deux roues qui s’avance, des centaines d’engins, les phares allumés, tenant toute la largeur de la chaussée. Ils forment un véritable essaim. Une masse compacte, sombre et brillante à la fois, toute de cuir et de chrome.
Un instant hésitants, Véronique et Serge poursuivent leur marche. Les machines sont toutes de gros gabarit ; elles ont le look des années d’antan, longues, basses de selle, avec de gros garde-boue enveloppants, des réservoirs style « goutte d’eau ».
Au niveau du stade, la multitude quitte la route et bifurque pour prendre possession du terrain de sport.
Le bruit à présent est assourdissant. Ça pète, ça explose, ça pétarade.
Ce n’est que surenchère et tumulte. Ça pue aussi l’essence.
Pourtant, le plus impressionnant n’est pas tant le nombre ni le bruit ni même l’odeur, mais l’uniformité de la meute. Les motos se ressemblent, noires et nickel. Les motards sont clonés. A l’image du couple aperçu au café, ils portent la même combinaison de cuir, ouverte sur le même tee-shirt et arborant la même casque en forme de calotte. La tenue, banale en soi, devient terrifiante quand elle se répète à deux ou trois cent exemplaires.
« L’armée de Wotan ?! » se dit la journaliste. La nuée se range progressivement le long du local du FC Club qui jouxte le stade. On cale les engins, on se dégourdit les jambes, on chahute. L’un des conducteurs, furtivement, fait le salut nazi, histoire sans doute de se détendre les articulations.
Une escouade de side-cars termine le défilé. Elle improvise un moto-cross dans les champs autour du stade et finit par se ranger à son tour.
Les derniers staccatos des motos s’arrêtent. On n’entend plus à présent que les cris, les rires, les plaisanteries des occupants du site. Un ballon est apparu, quelques joueurs se le disputent.
Très vite, le camp s’installe, de premières tentes « igloo » se montent.
« Putain, tu vois ce que je vois ? »
Le couple n’est plus qu’à quelques mètres du campement. Serge est blafard. Sur le bord du chemin, une demi douzaine de motards les regardent, goguenards. Véronique corrige sa première impression : vus de près, les visiteurs n’ont pas tous la même allure. Les uns ont l’air de petites frappes, les autres de gosses de bonne famille. L’un des bourges, d’ailleurs, le tee-shirt retroussé sur son torse nu, exhibe sur sa poitrine le chiffe 88 tatoué à la gothique.
« 88. Ou deux fois la huitième lettre, le H. Soit HH ou Heil Hitler » décrypte-t-elle à mi-voix. On trouve le même sigle sur les tombes profanées, a-t-elle lu dans la presse locale.
Les ricanements continuent de plus belle quand un ordre, aboyé par un type filiforme, à l’entrée du club, lunettes rondes, l’air hargneux mais retenu, calme la troupe. L’intello de service semble être le chef de l’équipée. Ses sbires, disciplinés, se replient en bon ordre, tout en éructant.
On entend les premiers échos d’une musique syncopée. Aigle, traits tirés, traduit le refrain :
« Le match est fini
on est à la buvette
le stade est à nous ».
– C’est de circonstance, dit-elle.
– C’est le groupe « Abattoir ».
– T’écoutes ça, toi ?
– Je m’informe…
Véronique et Serge font demi-tour. Ce dernier semble foudroyé :
« On est où, là ?
– Au milieu de néonazis allemands !
– Ici ?!
– Ils prospèrent en Allemagne mais la loi là-bas sur le droit de réunion est stricte.
– Alors ?
– Alors ils passent la frontière, pour se rassembler dans des villages alsaciens.
– Comment tu sais ça ?
– Je m’informe.
Il a un haussement d’épaules, agacé.
– Ils peuvent le faire ?
– La preuve ! En toute impunité.
– Et c’est tout ce que ça te fait ?
– Oh, calme toi, j’y suis pour rien.
– C’est fréquent ?
– Chaque année, il y aurait plusieurs assemblées de ce type.
– Dans le village de Cesare !?
– Ça par contre, c’est un scoop !
Les gendarmes sont toujours là.
Aigle, l’air défait, va les saluer, leur demande ce qu’ils pensent de l’armada.
« On observe, on est là pour ça.
– Vous saviez qu’ils arrivaient ?
– …
– Vous comptez intervenir ?
– Là, faut voir les autorités ».
De retour au café, l’humanitaire est surexcité. Il raconte leur découverte à Boreli et Federmann-Dutriez ainsi que l’échange avec la maréchaussée ; il recherche dans l’annuaire les coordonnées de la mairie de Rodinger.
– Qu’est ce que tu fais ?
– Je veux parler au maire.
– C’est un vrai con !
– C’est pas mon problème.
Serge ne remarque même pas la photo, au dessus de l’appareil fixe, où l’on peut lire une formule pas très oecuménique : « Tuons tous les curés ».
La mairie évidemment est fermée ; il finit par joindre l’édile de permanence. Prudent, l’autre hésite, il ne veut rien dire. Aigle se fait pressant.
« Vous allez laisser faire ?
– Ces visiteurs ont bien réservé le club-house…
– Le club-house ? Serge s’étonne du jargon.
– Le club-house du football-club, oui, et pour le week-end.
– Et alors ?
– Alors, on ne peut rien faire.
– Comment ça ?
– C’est légal ; ils ont payé, cash d’ailleurs, le jour même de la réservation ; ils ont le droit d’être là.
– Mais le droit de quoi ?
– Hé bien, de se réunir.
– Mais ils avaient dit pourquoi ils se réunissaient ?
– Pour un tournoi de football.
– Du football ! Non mais, vous les avez vu ?
– Non !
– Faut les voir ! Ils ont des dégaines de nazis ! Ce sont des nazis !
– Ils sont en règle, je vous le redis.
– Donc, vous ne ferez rien.
– Je répète : on ne peut rien faire.
– C’est fou !
– Tant qu’ils font « ça » dans un cadre privé…
– Ça ? quoi ça ?
– Hé bien, leurs gesticulations politiques, disons.
– Donc ?
– Tant qu’ils font ça dans la salle, on ne peut rien faire. Dehors, ce serait autre chose.
– Vous parlez sérieusement ?
– Tout à fait sérieusement. Je suis désolé, c’est la loi, c’est comme ça. Même si je voulais interdire l’assemblée, je n’aurais aucun moyen d’intervenir.
– Et la gendarmerie ?
– Kif kif. Elle est comme nous.
– Elle est sur place pourtant.
– Elle fait du repérage. Au cas où.
– Alors, vous ne bougerez pas ?
– Vous êtes têtu, vous alors ! Pour bouger, il faut un « trouble de l’ordre public ». Or tout est ok, c’est clair. Tant que les choses se passent dans le club, c’est de l’ordre du privé ; et une affaire privée, c’est pas de mon domaine. On ne peut rien faire. Et on ne fera rien. Bonjour chez vous !
L’élu raccroche.
Aigle explose :
« Putain ! Le village va rester indifférent à ce qui se passe à 500 mètres de son périmètre ?! Car officiellement, il ne se passe rien ! Rien qu’un match de foot amical, qu’une réunion privée comme une autre. Un peu nazie sur les bords peut-être, mais privée. »
L’humanitaire est très en colère ; il interpelle Boreli, le bras tendu, vindicatif.
« C’est le village des trois singes, ton Rodinger ! On ne voit rien, on n’entend rien, on ne dit rien ! ».
Cesare ne répond pas.
10
STRASBOURG, été 1945
Bleu.
Pendant un an, il ne se passe rien dans les caves de l’Institut, dans cette fameuse chambre onze. Ou pas grand chose. En tout cas, il ne se passe pas ce qu’August Hirt désirait. Il comptait bien s’occuper de son « matériel », désarticuler les corps, séparer les têtes, récurer les os, monter sa collection de squelettes, travailler la présentation, l’esthétique de la future exposition, mais il a trop peu de temps. Depuis la fin 1943, le patron d’Anatomie est sous pression.
Selon Mlle Adler, les nouvelles du front, à l’Est, puis le débarquement en Normandie inquiètent l’appareil nazi. Berlin entend coûte que coûte contre-attaquer, reprendre l’offensive, surprendre. Hitler fantasme sur ces armes nouvelles susceptibles de lui redonner l’avantage ; il pourrait s’agir d’armes chimiques, de gaz foudroyants, d’armes bactériologiques, autant de sujets de recherche du trio Hirt, Haagen et Bickenbach.
Ces médecins sont fortement sollicités par l’administration hitlérienne. Ils doivent hâter leurs investigations. Pas moyen de faire autrement, la collection attendra. Au Struthof, on expérimente une nouvelle variété de phosgène, un gaz de combat. Il va être testé, d’octobre 1943 à novembre 1944, sur des Tziganes, des Russes, des Polonais. On innove, en utilisant désormais des ampoules contenant du gaz liquide ; il suffit de les briser sur le sol de la chambre à gaz puis de refermer rapidement la porte sur les détenus. Il se dit que cette méthode des capsules a un bel avenir.
August Hirt est débordé. J’ai retrouvé de lui une lettre du 5 septembre 1944 – Paris était libérée depuis quelques jours !- où il se plaint « de ne pas avoir terminé la réduction des corps ».
Dans les sous-sols de l’Institut, les préparateurs, pendant de longs mois, se contentent d’entretenir leurs sujets d’expérimentation en ajoutant régulièrement de l’alcool dans les cuves. Depuis plus d’un an, les 86 sacrifiés stagnent dans un bain infâme. Les anatomistes ont quotidiennement sous les yeux cet empilement de cadavres, cette monstrueuse « farandole » que forment ces êtres encastrés les uns dans les autres, mélangés, emmêlés, enchevêtrés, unis et anéantis. On a du mal à imaginer ces appariteurs, sorte de Quasimodo vert-de-gris, s’habituer à cette préparation d’épouvante. C’est pourtant le cas, semble-t-il.
Mais la descente aux enfers n’est pas terminée. C’est un peu comme si, dans cette affaire, l’abomination était sans limite. On est fin septembre 1944. La rapidité de l’avance alliée se confirme. Belfort est libéré. Les gens de l’Ahnenerbe s’agitent. L’idée qu’on puisse découvrir leurs macabres expériences finit par inquiéter ces savants. Ils s’interrogent sur la marche à suivre : faut-il saborder l’opération ? Ou trouver un arrangement ? Wolfram Sievers écrit au grand patron des médecins nazis à Berlin :
« En raison du travail scientifique considérable, la préparation des squelettes n’est pas encore terminée. Hirt demande ce qu’il faut faire de la collection au cas où Strasbourg serait en danger. Il peut les mettre à macérer et les rendre méconnaissable. Mais dans ce cas une partie de l’ensemble du travail aurait été faite en vain et ce serait une grande perte scientifique pour cette collection unique car les moulages ne seraient plus possibles. La collection, telle qu’elle existe actuellement, n’attire pas l’attention. On pourrait dire qu’il s’agit des restes des cadavres pris à l’institut d’anatomie où les Français les auraient laissés et on les brûlerait. »
Cette lettre, mon commandant, est à mes yeux la plus implacable preuve à charge contre ces mandarins. On y mesure la duplicité de savants qui d’un côté affichent des délires de surpuissance mais mesurent la responsabilité de leurs actes et s’inventent déjà de minables mensonges. « On pourrait dire que… »
Il y est aussi question de moulages. Cela pourrait signifier que nos chers professeurs envisageaient toute une mise en scène de leur « travail », non seulement avec l’alignement des crânes dans une galerie des sous-espèces, nous l’avons dit, mais sans doute aussi une présentation, moulée, des têtes coupées. C’est ainsi du moins que j’entends la lettre de Sievers.
Octobre 1944. Il commence à régner dans les couloirs de l’Université nazie une ambiance de débâcle. August Hirt, par défi ou inconscience, aime encore y faire résonner un de ses lieders familiers, texte de Heinrich Heine, musique de Richard Strauss :
Mit deinen blauen Augen
Siehst du mich lieblich an
Da ward mir so traümend zu Sinne
Dass ich nicht spechen kann
De tes yeux bleus
Tu me regardes délicieusement
Et mon esprit se fait si rêveur
Que je ne puis parler.
Mais son entourage donne des signes de panique. Mlle Adler en convient.
En vérité, le patron de l’Institut ne croit plus à la possibilité de « sauver » sa collection. Désormais, sa priorité, c’est que l’on efface l’identité juive des cadavres et que l’on masque leur qualité de prisonniers exécutés, pour le cas où ils tomberaient entre les mains de Alliés. August Hirt charge de cette besogne deux garçons de salle.
Mais il y a trop de corps, trop de travail, le temps leur manque pour mener à bien cette tâche infernale. Les Allemands prennent la fuite, en catastrophe, alors que la 2e Division blindée de Leclerc accélère sa marche et entre à Strasbourg le 22 novembre 1944.
Il pleuvait ce jour-là sur la ville mais la fête fut belle, dit-on. Un spahi escalada la flèche de la cathédrale pour y accrocher un drapeau tricolore confectionné à la hâte par une bouchère, en se servant d’un drap pour le blanc, d’un drapeau nazi pour le rouge et d’une blouse pour le bleu.
Il paraît que l’étendard affichait beaucoup plus de bleu que de blanc et de rouge.
Le bleu, mon commandant, est la plus profonde des couleurs, la plus froide, la plus pure, la plus immatérielle aussi. La mer n’est bleue que par l’accumulation du vide, tout comme le ciel. Nos rêves sont bleus, dit-on.
Irréel ou surréel, le bleu est indifférent, inhumain. Mais le bleu apaise, le bleu est évasion. Le bleu était donc dominant dans le drapeau flottant sur la ville libérée.
Le général Leclerc fit placarder des affiches dans toute la ville, il en reste encore une non loin de la caserne où j’ai pris mes quartiers : « Habitants de Strasbourg, pendant cette lutte gigantesque de quatre années, la flèche de votre cathédrale a été notre obsession ». Dans l’intimité, le général a été plus direct, m’a-t-on dit ici. Il s’était fait, à Koufra, en Lybie, en 1941, le serment de libérer Strasbourg. La mission étant accomplie, il dit aux siens : « Maintenant, on peut crever ».
La ville va connaître la liesse de la Libération. Les nouvelles autorités s’installent et le 1er décembre, le commandant Raphaël, du service cinématographique des armées, visite l’hôpital civil ; il est à la recherche de matériel photo allemand.
Dans le laboratoire d’August Hirt, il fait une drôle de découverte. Le professeur a laissé derrière lui une bombe puissante à oxygène liquide de 10kg ; elle était manifestement destinée à provoquer la destruction de son installation et faire disparaître toutes traces compromettantes. Mais dans la précipitation du départ, le directeur de l’Institut oublie, ou n’est pas en mesure, de recourir à cet expédient. Peut-être aussi hésite-t-il, en dernière instance, à détruire son œuvre ?
Le commandant Raphaël fait désamorcer la bombe. Alerté, on le serait à moins, il procède à une inspection méthodique de l’Institut. Et il tombe, dans les sous sols, chambre 11, sur une vision d’apocalypse ! Lui qui ne connaît pas encore toute la vérité, termine ainsi son rapport transmis aussitôt à nos services :
« En résumé, le nombre de cadavres, la manière anormale dont ces corps ont été amenés à l’hôpital, les précautions prises pour pouvoir faire disparaître toutes traces de ces installations, enfin les déclarations des employés attachés à ce service prouvent que le professeur Hirth (sic) était un triste personnage dont l’activité est à mettre en lumière. Il semble qu’on se trouve en face d’une manifestation de la barbarie allemande ».
C’est cette communication du commandant Raphaël qui m’a conduit ici. Son exposé était concis. Si bien que je ne savais pas trop à quoi je devais m’attendre mais durant tout le trajet de Paris à Strasbourg, j’étais littéralement obsédé par cette chambre, par ce chiffre onze. Cela me hantait. Il m’était arrivé d’organiser, mon commandant, à l’école des arts appliqués, une conférence sur la symbolique. J’aimais montrer en effet à mes élèves la richesse qu’il peut y avoir dans cette triade : le réel, le symbolique et l’imaginaire. Or le chiffre onze est le signe de l’excès, de la démesure, du débordement, de la violence. Le onze marque une rupture, une faille dans l’univers. Augustin ne disait-il pas déjà que « le nombre onze est l’armoirie du péché ». Le onze est décidément un chiffre inquiétant qui représente la faute, le désordre. Par quelque bout qu’on le prenne : selon l’addition théosophique, les deux chiffres de 11 donnent deux, nombre néfaste de la lutte intérieure, de l’égarement, de la transgression de la loi, du péché, de la révolte des anges !
Tout cela, mon commandant, est bien éloigné du droit, me direz-vous et je le reconnais volontiers. Mais c’est dans cet état d’esprit que j’arrivais à Strasbourg. Je m’attendais donc au pire. Il n’en reste pas moins que le spectacle que m’offrit la chambre onze reste pour moi l’image absolue de l’outrance.
11
Samedi 14 mai
20h
« … Il n’en reste pas moins que le spectacle que m’offrit la chambre onze reste pour moi l’image absolue de l’outrance. »
Véronique est littéralement électrisée par la lecture du journal de bord, une mauvaise photocopie en fait du texte original. En fin d’après midi, elle s’était retrouvée, seule et désœuvrée, dans les couloirs du Jérusalem. Boreli avec Federmann-Dutriez s’étaient rendus dans un centre commercial des environs, histoire de ré-approvisionner le garde-manger. Serge, taciturne depuis l’incident du stade, assurait la permanence du bar. Elle était entrée dans la chambre de ce dernier, à la recherche d’un collier égaré. Il flottait dans la pièce une fragrance presque familière ; elle en ressentit un léger frisson ; c’était délicieux. Un document trônait sur le lit. Il semblait attendre le visiteur. Indiscrète, elle avait commencé par le feuilleter, machinalement. Puis, intriguée, elle se mit à le lire. Elle ne put s’en extraire.
La nuit à présent est en train de tomber.
Elle s’apprête à prendre connaissance de l’expertise finale des médecins légistes. Elle est loin de cette chambre, loin de Boringer, loin de tout. Pourtant son instinct l’alerte. Il y a comme une légère modification de l’air. Elle comprend trop tard que quelqu’un la regarde. Elle se retourne. Aigle est dans l’encadrement de la porte.
– Faut pas se gêner !
– Pardon ! Ça ne se fait pas, c’est vrai, mais je suis tombé sur ce texte et…
– Tu serais pas un peu flic, des fois ?
– Déconne pas !
– Donne ce texte !
– Mes excuses…
– Je me fous de tes excuses !
– Tu sais, quand un historien trouve une archive…
D’un geste brusque, il récupère le document.
– Dégage !
Serge est décomposé. Véronique ne bouge pas. Elle s’attend à tout, à ce qu’il la frappe, peut-être. Il reste planté devant elle, cambré, pris de tremblements nerveux, le regard hargneux, les bras serrant contre sa poitrine le manuscrit. Ils demeurent un long moment côte à côte, silencieux. Puis, lentement, précautionneusement, la jeune femme se redresse, s’approche de lui, lève son bras, lui caresse le visage, les cheveux. Il se laisse faire. Cela dure. L’humanitaire retrouve un semblant de calme. Véronique reste sur ses gardes, le caresse encore et encore. Il la regarde, semble rendre les armes, se met à parler.
« J’étais au fin fond de l’Afrique quand cette histoire m’a sauté à nouveau à la figure. Je pensais avoir tout oublié, tout enfoui, je croyais avoir pris à jamais mes distances avec ce cauchemar… Mais je suis tombé un jour, chez des amis, sur un numéro du Monde Diplomatique. Il était daté d’août 1993. Je l’ai toujours gardé sur moi. »
Il sort maladroitement de son portefeuille une vieille coupure jaunie.
« J’ai toujours aimé lire le courrier des lecteurs. Quand j’ouvre un journal, je commence par cette rubrique. Ce jour-là, une correspondance m’intrigua. Elle était signée par un certain docteur Charles Mager. Le type, psychiatre en Israël, à Haïfa au moment de la lettre, était né en 1921, en Allemagne. D’origine polonaise, il était arrivé avec sa famille en France dès 1922. »
Il lui tend l’articulet, elle lit :
C’est l’époque après la Libération. Je suis étudiant en médecine, première année. J’entre dans la grande salle d’autopsie de l’université de Strasbourg. Je m’apprête à commencer la dissection du cadavre. Je m’aperçois que tout son corps est parcouru de profondes meurtrissures. Il est circoncis. A titre de curiosité, je me mets à parcourir toute la salle de dissection, en m’arrêtant attentivement devant chaque table. Tous les cadavres, hommes et femmes, sont profondément marqués par des coups. La plupart des hommes sont circoncis. Je retourne à ma place. Le professeur d’anatomie me dit de commencer la dissection. Je ne puis. Je suis dégoûté. J’ai envie de vomir. Je décide de réunir, au milieu de la salle, un comité de tous les étudiants juifs, pour protester. Ils n’osent, ils ont peur, ils se dérobent. Alors, seul, décidé à agir, je me rends, par une nuit froide d’automne, chez le rabbin de la ville pour lui fournir toutes les explications. Le lendemain, tous les cadavres, qui de leur vivant ont été torturés à mort, ont disparu de la salle de dissection. Je peux alors en sérénité et en toute bonne conscience reprendre ou plutôt commencer mes leçons de dissection.
Elle hésite à comprendre. Il explique :
« Tapis au fin fond de ma mémoire, de méchants souvenirs ressurgissaient. Cette affaire n’en finirait donc jamais. J’avais pourtant coupé tous les ponts, près de vingt ans plus tôt, en 1976. »
L’humanitaire soupire, comme s’il évacuait une trop forte charge.
« Doctorant, j’avais entrepris une thèse sur l’histoire de la fac de médecine durant la dernière guerre. Mais je n’ai pas mené à son terme cette recherche. Au cours de ce travail, j’avais découvert ce journal de bord du capitaine Adam Meeropol, que j’avais photocopié en douce. J’étais tombé aussi sur des archives plus « personnelles » si j’ose dire. Notamment un acte d’Etat civil signalant le changement d’identité de cette fameuse Mlle Adler, dont il est abondamment question. Grâce sans doute à l’intervention du capitaine, celle-ci avait francisé son nom. Elle ne s’était pas donné beaucoup de mal, il faut bien dire, se contentant de traduire Adler. Qui signifie en français… aigle. Hélèna Adler devenait Hélène Aigle ! Hélène Aigle... Comme ma mère ? Choqué puis affolé, je vérifiais les dates et le lieu de naissance. Il ne pouvait s’agir d’une simple homonymie : c’était bien ma génitrice ! L’ex-secrétaire d’August Hirt était passée à une semi-clandestinité et devenue infirmière dans un village retiré d’Alsace. »
Livide, l’humanitaire presse entre ses mains le manuscrit, le tord, s’en frappe le visage.
« Jusque là, quand je l’interrogeais, elle n’était jamais très précise sur son activité pendant l’Occupation. Elle aurait été vaguement étudiante et gagnait sa vie en travaillant dans une pharmacie du centre de Strasbourg, disparue dans les bombardements. Ce n’était pas tout à fait ce que disaient ces archives. Lesquelles étaient parfaitement crédibles. Perspicace, l’auteur du journal insinuait que la secrétaire de Hirt avait été également la maîtresse du professeur Haagen. Dont elle était enceinte au moment des interrogatoires de l’été 1945. Cet enfant à naître lui avait grandement épargné d’éventuelles poursuites. Moi même, je suis venu au monde fin août 1945. Je me souviens encore du tournis qui me prit quand je formulais cette question : étais-je le bâtard de Haagen !? »
D’un coup de pied rageur, Serge envoie valdinguer la table de nuit qui se fracasse contre le mur.
« L’enfant illégitime de l’ancien directeur de bactériologie ! J’ai cru sombrer… Je me mis alors à la harceler, comme un forcené, à l’injurier, je me sentais prêt à tout ; elle encaissa, d’abord, en silence ; puis elle confirma, à mi-mots, apparut complètement démontée par mes demandes répétées puis mourut. De lassitude et de peur sans doute. C’était finalement plus simple pour elle que de répondre à de nouvelles questions. »
L’humanitaire balance ses phrases d’un ton saccadé, un peu comme s’il boxait.
« Elle m’avait toujours dit que j’étais fils de toubib, plus exactement d’un jeune anatomiste du nom de Mesplède, Henri Mesplède. Elle ne cessait d’ailleurs de me dire que je serai toubib, comme lui, et peut-être qu’un jour je serais nommé à l’institut d’anatomie, qui sait ? Cette idée l’obsédait. Je ne comprenais pas bien pourquoi. Mon père, disait-elle, s’était engagé dans la 2è DB, aux côtés de gens prestigieux comme Jean Nohain, Jean Gabain, Jean Marais. Il avait participé à toute l’épopée de Leclerc, depuis la bataille de Koufra, jusqu’aux combats en Alsace, en passant par la libération de Paris. Elle l’avait rencontré, disait-elle, le jour de la Libération de Strasbourg. Il conduisait une des premières jeeps à être entré en ville. »
Serge émet un grand rire rauque comme un cri de fauve et agite à bout de bras le rapport pour chasser un adversaire imaginaire.
« Et moi, tout un temps, je l’avais écoutée, j’avais marché dans sa combine, que dis-je marché, courru oui ! J’avais tellement rêvé de ce père mythique. Mon héros. Je connaissais par coeur leur idylle : elle l’avait croisé dans les farandoles de la Libération et avait eu aussitôt le coup de foudre pour ce type fabuleux, timide et désinvolte à la fois. Ils pleuraient de joie, ajoutait-elle, mais leur amour fut éphémère. Ils n’étaient restés que quelques jours ensemble. Sa compagnie passait, courant décembre, en Allemagne. Il était mort, à la croire, un peu plus tard, dans des combats en Bavière. Déchiqueté par l’explosion de sa jeep sur une mine. Avec tout l’équipage…Longtemps, j’ai vécu avec cette légende. Il y avait même à la maison tout un pan de mur qui était réservé à notre cher disparu : une photo, un peu floue c’est vrai, aux pieds de la cathédrale, le jour de la Libération ; on le distingue vaguement, assis dans son engin, décapotable, sur lequel ont pris place, debout, souriantes, les bras dressés, écartés, des jeunes filles en habits traditionnels alsaciens, la grande coiffe noire, une étole colorée sur un chemisier blanc, une longue robe bleue ou rouge. La passagère la plus à droite, c’était elle. Et puis, encadré, un certificat militaire rappelait les faits d’arme du disparu. J’ai cru naturellement à cette fable. Ardemment. Elle a porté mon enfance. Mais je n’ai guère eu de mal à constater, par la suite, ma mère venait de décéder, que la photo était tronquée ; le document de l’Armée, lui, était un montage grossier. Foutaise et compagnie ! »
Un craquement les fait sursauter. Ça vient du grenier. Véronique a remarqué, lors de la visite de l’immeuble avec Cesare, que la charpente travaillait méchamment. Il ne manquerait plus qu’elle se prenne le toit sur la tête. Elle se demande combien de temps le café va tenir. « Jérusalem » peut-elle s’effondrer ? Cette idée la rend tout chose. Comme si elle s’attachait déjà à ce drôle d’endroit.
Elle encourage Serge à poursuivre.
« Bâtard de Haagen ! La nouvelle m’avait fait perdre pied, littéralement. J’avais l’impression que mes jambes ne me tenaient plus. Je ressentais en permanence des vertiges. Cette même année 1976, un autre incident acheva de me déstabiliser. Il ne me concernait pas directement et pourtant… Les fachos locaux, des Alsaciens d’ultra droite, avaient attaqué le Struthof ! Une nuit, lors d’une véritable opération commando, ils s’étaient livrés à une agression en règle contre le site ! Attaquer un ancien camp, c’est génial, non ? Jusque là, ils s’en prenaient aux gens, aux couleurs, aux idées. Mais un camp ?! Et quel camp ! Les nazillons avaient incendié un des bâtiments préservés jusque là, le baraquement qui servait de musée, tout en haut de l’installation. De cette salle, la plus importante en fait, ne restait que des planches calcinées, des brandons et un tas de cendres. C’était leur façon d’enfouir l’histoire. De tourner la page. La presse, gênée aux entournures, avait modestement couvert le saccage. C’était plus que je ne pouvais supporter. Ce pays, ces gens, les miens me faisaient horreur. Plein de honte et de fureur, je choisis de fuir. Mon diplôme en poche, j’allais me cacher dans le trou du cul du monde. Je trouvais refuge chez les « damnés de la terre » : entre maudits, on se comprit. »
Epuisé, amer, l’humanitaire s’affaisse sur le lit. Mais son histoire n’est pas terminée. Il reprend.
« Mais vingt ans plus tard, l’article du « Monde Diplomatique » me tirait de ma torpeur. Je me réveillais en quelque sorte, la rage intacte. Mes souvenirs revenaient, en avalanche. Je n’acceptais pas cette impunité dont avaient bénéficié les toubibs SS, à commencer par mon géniteur. Si des tueurs comme Josef Kramer, un exécutant finalement, avaient été châtiés, les médecins nazis et leurs équipes s’en étaient tirés à bon compte. Schmidt, le recteur ? Il avait repris du service dans l’administration. Stein, le doyen de médecine ? Il était retombé sur ses pieds sans encombres. August Hirt ? Il se réfugia à Tubingen qu’il fuit en avril 1945 ; on le retrouva dans un camp SS au sud de la Forêt noire ; puis il tenta de rejoindre la Suisse. Il fut localisé dans le village de Schonenbach, logé par le maire ; il joua même les intermédiaires entre les soldats français et les autorités locales ! Le 2 juin, dans un bois des environs, il se suicida et échappa au châtiment. »
Véronique se demande si l’ex directeur de l’Institut d’anatomie gargouillait encore, le canon dans la bouche, un lied straussien ? Par exemple « Allersseelen », Le jour des morts. C’était de circonstance :
Stiel auf den Tisch die duftenden Reseden
Die letztenroten Astern trag herbei
Und lass uns wieder von der Liebe reden
Wie einst imMai.
Pose sur la table les résédas odorants
Apporte les derniers asters rouges
Et que nous parlions à nouveau de l’amour
Comme jadis en mai.
« Haagen, le géniteur, fut arrêté par les Français de même que Bickenbach. Jugés à Metz, en 1952, ils furent faiblement condamnés et rapidement libérés. Otto Bickenbach exercera en qualité d’interne de l’hôpital de Siegburg ; Eugen Haagen finira mandarin à Berlin. Bruno Beger, l’anthropologue, qui échantillonna le bétail humain à Auschwitz, n’écopa que de trois ans de prison. Ce n’était pas cher payé. Les « savants » étaient saufs. L’institution médicale, cette élite qui avait pendant des années procédé à des expériences sur les « versuchspersonen », les personnes de laboratoire, comme ils disaient, était préservée. Et leurs bras armés alsaciens également. »
Cholé croit entendre des pas dans le couloir. Elle tressaille. Elle s’en veut d’avoir peur aussi facilement. Elle a dû confondre avec les torsions de la maison, les convulsions de l’hôtel. « Cesare ? C’est toi ? ». Silence. Serge n’a rien remarqué. Il continue.
« Cette impunité m’était d’autant plus insupportable qu’elle remuait en moi un très vieux souvenir. Une rumeur courrait les milieux de la fac de Strasbourg, confusément ; une rumeur insistante, transmise d’année en année, jusqu’à notre génération de 68. Je faisais mine de ne pas le savoir mais j’avais pourtant bel et bien entendu dire, au début de mes études de médecine, que des restes des martyrs de 1943 avaient continué de servir de cobayes aux étudiants après guerre. Des profs en avaient fait des coupes anatomiques remarquées. L’embryologiste Walter Birmann par exemple était très fier de les montrer à ses élèves comme éléments de grande valeur scientifique. Rolf Birdof, autre anatomiste strasbourgeois, pouvait défendre, dans une revue médicale suisse, au milieu des années soixante, sa position expérimentale extrémiste sans être officiellement contredit, je connais le texte par coeur : « L’animal expérimental idéal est l’homme. Chaque fois qu’il est possible, il faut prendre l’homme comme animal d’expérience. Le chercheur clinique doit avoir à l’esprit que pour connaître les maladies humaines, il faut étudier l’homme. Il n’est pas de recherches plus satisfaisantes, plus intéressantes et plus lucratives que celles effectuées sur l’homme. Il nous faut donc aller plus loin dans la recherche sur le plus développé des animaux, l’homme ».
Véronique, effarée, songe au courrier des lecteurs du « Monde Diplomatique ».
« Cette affaire ne fut jamais publiquement évoquée. Il n’y eut aucune information donnée, aucune enquête, aucun débat. Les autorités se contentèrent de nier, parlèrent de légende. Comme on sait si bien le faire en Alsace, un silence ouatée s’installa. « Les résistances sont énormes », répétait-on. » On tournait la page, comme le disait Federmann-Dutriez. »
Bouleversé, l’humanitaire a du mal à retenir sa furie, à la dompter. A présent, il susurre, comme s’il fallait baisser le ton pour être mieux entendu mais cette voix, à peine dominée, semble annoncer le tonnerre.
« Je commençais à prendre des nouvelles des toubibs. Depuis le Congo, ce n’était pas très simple. Mais avec Internet, j’avançais malgré tout. Pas de traces de l’ancien recteur, ni de l’ex-doyen de la fac de Médecine.
J’avais retrouvé les coordonnées de mon géniteur. Une fois ou deux, je lui avais même téléphoné. Mais au dernier moment, j’avais été incapable d’articuler quoi que ce soit. Je l’écoutais s’impatienter au bout du fil. Il avait une voix forte, pas du tout diminuée, celle d’un homme longtemps habitué à commander. Peu de temps après, j’étais tombé sur une coupure de presse : Eugen Haagen avait fait une crise cardiaque, on l’avait trouvé écroulé au volant de sa voiture alors qu’il s’apprêtait à sortir de son garage ; le moteur tournait ; avait-il été asphyxié par les gaz d’échappement ? Je me suis dit que mes appels avaient fini par l’inquiéter jusqu’à provoquer sa mort ; mais c’est peu probable. Et de toute façon, cette fin fut bien trop douce. Il avait de la chance. Si j’avais pu le croiser, je ne l’aurais pas épargné. Du moins, j’espère que je n’aurais pas flanché. Otto Bickenbach, lui, s’était noyé dans sa piscine, du côté de Marbella, sur la côte andalouse ; un vrai panier de vieux crabes vert de gris, cette région ! Je n’eus guère de mal par contre à localiser leurs assistants alsaciens, ceux que le rapport appelle le quarteron de collabos. Ils avaient fait carrière et ne se cachaient guère. Ils avaient même retrouvé de l’assurance avec l’âge. Kougelman avait présidé un comité de soutien au Front national, Birmann avait été élu local autonomiste. Birdof et Hauser étaient rangés des voitures mais tous ces toubibs avaient flirté ouvertement, sur leurs vieux jours, avec l’ultra-droite. Rien ne changerait donc jamais. Les victimes demeuraient bafoués et les bourreaux préservés. A croire, comme disait je ne sais plus qui, que « les bourreaux font moins peur que les victimes ». La justice des hommes était défaillante, je décidai de rendre la mienne. C’est d’ailleurs ce que j’aurais dû faire il y a longtemps.
Véronique ne veut pas en entendre plus. Elle qui le pressait de parler panique soudain à l’approche des aveux. Elle se lève, sort. Il la suit, il crie à présent. Elle court, n’entend pas tout ce qu’il dit.
« …Le hasard faisant bien les choses, je reçus une invitation de ce vieux Boreli. Il s’agissait de créer une sorte d’amicale des anciens de 68. Je trouvais l’idée dérisoire mais opportune. Mes mandarins allaient payer. »
– Tais-toi, supplie-t-elle.
Elle dévale les escaliers. Les mains sur la rambarde, il hurle :
« Je ne crois ni au pardon, ni à la repentance. Notre histoire et notre malheur sont sans fin. »
Elle trébuche, ne parvient pas à retrouver son équilibre, plonge littéralement sur la carrelage de l’entrée et glisse vers la porte que sa tête vient heurter d’un bruit sec. Un trou noir l’aspire.
12
STRASBOURG, été 1945
Rouge.
Je me suis rendu une bonne dizaine de fois dans la chambre 11 et j’en suis systématiquement sorti anéanti, pulvérisé, incapable d’agir et de penser pendant des heures ; même la peinture ne m’était alors d’aucun secours. Mais la visite la plus impressionnante de cette catacombe est celle que j’y ai faite, voilà un mois, avec les trois médecins légistes chargés de procéder à un état complet des lieux. J’ai joué au cicérone pour les professeurs Becdelièvre, un parisien du Val de Grâce, Fourmonin et Sicade, de Strasboug.
Comme ils disposaient de peu de moyens, j’ai tenu à les assister. J’ai participé à leurs investigations, en plein accord avec eux bien sûr même si, côté procédure, ce n’était pas de ma compétence ; j’aggrave mon cas en ajoutant que je leur ai même servi de greffier.
J’avais déjà une assez bonne connaissance du dossier quand je retournais dans cet enfer avec eux mais je me suis gardé de trop leur en dire, afin de voir si leurs propres analyses allaient confirmer ou non ma recherche. De ce point de vue, je n’ai pas été déçu : leurs relevés ont totalement corroboré mon enquête.
L’Institut m’est devenu familier, si j’ose écrire. L’accès principal est fermé, il porte d’ailleurs des scellés ; on doit emprunter une entrée annexe. Les bureaux, sur deux étages, sont dans un grand désordre, armoires ouvertes, meubles renversés, fauteuils brisés ; tout est resté exactement dans l’état où l’ont laissé les Allemands, m’ a-t-on dit.
L’ensemble paraît désert mais dès qu’on accède au sous-sol, on tombe sur un personnage taciturne, la démarche traînante, comme surgi de nulle part. Son apparition a sidéré les trois spécialistes, comme il m’avait effrayé, lors de ma première visite. Une tête de chien battu, inclinée sur la droite, des yeux exophtalmiques, il porte une longue blouse grise, toujours la même. « Garçon de salle Louispaul » dit-il en se présentant à chaque fois d’une voix sombre et sur un mode un peu militaire. « Un curieux nom ! » me suis-je dit au début. Le type n’a pas d’âge, entre quarante et soixante ans ; c’est un taiseux.
Louispaul, Alsacien, est le seul employé qui reste de l’équipe du temps de l’annexion, mais lui-même est entré dans le service en 1932. Autant dire qu’il fait partie du décor. Les autres ont fui, ou, comme Mlle Adler, se trouvent en résidence surveillée. Lui, pour des raisons indéterminées, continue son service. On dirait qu’il loge là, qu’il y dort, qu’il y passe sa vie, sans que personne ne trouve rien à redire. Sa connaissance des lieux lui sert de passe-droit.
Le sous-sol forme un long et large couloir carrelé, parcouru par une enfilade de néons ; de chaque côté du corridor, on dénombre six portes, de grosses portes en bois munies de clenches chromées, comme celles de frigidaires géants ; ces portes donnent sur autant de chambres.
« Russes ! » dit Louispaul, en désignant la chambre 7 ; c’est là en effet que se trouvaient les prisonniers de l’Est, terrassés par la tuberculose ; leurs corps servaient pour les travaux de dissection.
Dans la chambre 11, celle des 86, une odeur âcre, épaisse, accueille le visiteur. Les trois médecins commencent par autopsier les premiers corps qui se présentent, dix sept cadavres en tout, quatorze hommes, trois femmes. Cela leur prend plusieurs jours, même si les résultats des analyses sont, chaque fois, sensiblement les mêmes.
Je peux citer leur rapport de tête :
« Il s’agissait de personnes robustes et saines, jeunes pour la plupart, à qui les bourreaux n’ont pas laissé le temps de maigrir car il fallait au professeur Hirt des cadavres de sujets bien constitués pour les transformer en pièces anatomiques destinées au musée ».
Aucune d’entre elles ne présente de signes de maladie ; mais on mesure combien elles ont pu être maltraités :
« Il a été constaté, sur la plupart des corps, des traces de violences représentées par de petites brûlures, par des cicatrices et surtout par des ecchymoses parfois étendues et profondes situées le plus souvent au dos et à la tête. Ces ecchymoses provenaient indiscutablement de coups violents portés très vraisemblablement avec un bâton ou un gourdin. Les ecchymoses étaient d’âges différents. Il est donc manifeste que les victimes ont été frappées à plusieurs reprises et en particulier peu de temps avant la mort ».
Tous ont une large incision dans le fémur, effectuée sur le cadavre, par où a été injecté dans le corps un liquide conservateur. Les hommes ont le crâne rasée, les femmes portent des cheveux de 2 ou 3 centimètres.
Tous les hommes sont circoncis. Quelques uns portent sur le bras gauche un matricule tatoué, surmonté d’un triangle. Chez les autres, au même endroit, on distingue la trace d’une exérèse, comme si on avait retiré la peau pour enlever ces marques.
Ces hôtes de la chambre 11 ont un visage au teint terreux ; les dents sont serrées sur la langue ; du sang coagulé s’accumule dans la bouche.
L’examen intérieur des corps confirme qu’ils ne présentent aucun signe de maladie ; simplement on relève dans les poumons les mêmes lésions d’œdème pulmonaire aigu. Il s’agit donc bien de personnes gazées, qui offrent tous les symptômes de gens étouffés au gaz cyandrique.
Dans leur intestin, on retrouve systématiquement les restes d’un même repas, des épluchures de pommes de terre ; tout indique qu’ils ont été tués peu après avoir pris cette nourriture.
Les trois médecins légistes procèdent à l’autopsie des corps au fur et à mesure qu’on les retire des cuves ; il y a un tel empilement de cadavres qu’on s’attend à en trouver au total pas loin d’une centaine. Mais au troisième jour, alors qu’on vient de dégager un mort d’ une des cuves, on s’aperçoit qu’il s’agit de la dernière dépouille entière ; non pas que le reste de la cuve soit vide mais elle est désormais remplie… de bouts de corps. On fait le même constat dans les autres bassins : chaque fois qu’on y retire le dernier cadavre complet, on découvre un invraisemblable amoncellement de quartiers de mort. Le mot est obscène, on croit entendre un terme de boucherie. Ceci dit, c’est à une boucherie qu’on fait face ici, la plus infâme des boucheries, un carnage. Il y a là pêle-mêle des dizaines d’hommes-troncs ; des moitiés de cadavres constitués soit de thorax et de bras, mais sans têtes, soit de moitiés inférieures de corps, avec le bassin et les jambes. Ce puzzle macabre se complique encore car, dans les strates les plus profondes, on trouve des corps plus dépecés, des quarts d’homme si j’ose dire, essentiellement des membres. Cet émiettement, cette atomisation, cette dispersion nous laissent sans voix.
Commence la deuxième partie de notre travail : il faut plusieurs jours pour transporter, déplacer, regrouper ces pauvres bouts d’hommes et de femmes, pour tout recenser, noter à chaque fois le matricule du sujet, son sexe, la nature de la « pièce », les observations éventuelles comme des traces de coups, des particularités, etc.
Ce fut un effrayant jeu de patience que de remettre de l’ordre et de la raison dans ce chaos, de re-assembler ces individus broyés, une terrible comptabilité aussi.
Mon commandant, depuis ces jours insensés, j’ai gardé ces chiffres en tête, 34, 27, 34, 8, 36, 23, 37, 26… Comme une combinaison mortifère, une martingale du diable, une litanie morbide. Nos trois médecins font en effet le constat suivant : on est en face de 34 membres supérieurs droits d’homme, de 27 membres supérieurs droits de femmes, de 34 membres supérieurs gauches d’hommes, de 8 membres supérieurs gauches de femmes, de 36 membres inférieurs droits d’hommes, de 23 membres inférieurs droits de femmes, de 37 membres inférieurs gauches d’hommes, de 26 membres inférieurs gauches de femmes.
Un total de 168 quartiers ! Seigneur, quelle charade noire !
Et tous ces fragments représentent au moins 27 corps de femmes et 37 corps d’hommes.
Je pouvais alors reconstituer ce qui s’était passé dans cette chambre 11, entre la mi-octobre et la mi-novembre 1944. Les deux garçons de salle réquisitionnés par August Hirt, ce savant illustre, ce mélomane reconnu, tentent de dépecer les 86 … avec une scie mécanique. Les démons vont tronçonner, couper, découper, trancher.
Ils doivent tout à la fois sectionner les têtes, retirer les viscères, les unes et les autres étant incinérées au crématoire municipal de la Robertsau, enlever les tatouages du bras gauche, débiter les corps par quartiers. Des jours durant, les caves de l’Institut sont devenues la géhenne. Et la chambre 11 est rouge ; rouge pourpre est le sang, rouges sont les langues étirées, rouges ces caillots dans la bouche, rouge cette dévastation des corps, rouge cette sciure du « matériel » que des bûcherons appliqués débitent à longueur de journées. Rouge aussi cette terrible envie de meurtre, qui m’habite depuis, à l’encontre de ces gens. Et rouge ce cauchemar rédempteur qui me poursuit où Osiris, dépecé et jeté dans le Nil, est ressuscité par la magie d’Isis.
Les médecins légistes font sur ces quartiers d’homme les mêmes observations que sur les corps entiers : ils constatent des traces de coups, des hommes circoncis, des matricules maintenus ou retirés sur le bras. Mais surtout, ils finissent par différencier deux catégories de cadavres. La plus nombreuse est celle dont je viens de parler ; mais il y a aussi quelques portions d’individus décharnés, sous-alimentés, ravagés, morts de pneumonie.
Pourquoi cette différence ?La réponse s’est imposée d’elle même. Les bourreaux espèrent maquiller leur crime, masquer coûte que coûte l’identité des victimes de la chambre 11. Alors, comme de vulgaires criminels qui brouillent les indices et effacent leurs empreintes pour désorienter le limier, ces bonneteurs maudits veulent créer la confusion en mélangent les 86 avec des parties de cadavres décharnés « des Russes ! ». Comme si cette fraternité des morts pouvait faire oublier le forfait des vivants !
Mon commandant, j’arrive au terme de ce journal.
Je vais laisser partir Mlle Adler pour les raisons déjà dites. Le professeur August Hirt est en fuite, de même qu’Otto Bickenbach et Eugen Haagen. Le quarteron d’employés alsaciens les plus engagés dans cette aventure est dans la nature. On m’assure déjà, ici ou là, que ces derniers pourraient, demain, reprendre du service ! Je m’explique mal cette mansuétude ambiante à leur égard. A mon sens, leur responsabilité est entière. Mais des considérations d’ordre local semblent jouer pour eux. « Les pressions sont fortes » m’a-t-on répété. J’espère cependant que la justice sera en mesure de s’opposer à cette indulgence qui me paraît coupable. »
13
Dimanche 15 mai
0h30
Véronique traverse une fête foraine, bruyante et populeuse. Il fait nuit. Il pleut. « Approchez, mesdames et Messieurs, approchez » s’époumone un bateleur, un nain en uniforme kaki. Son stand est le plus couru de la foire. Le fronton en lettres de feu proclame : « Au palais des homoncules ». Sous l’effet de la bourrasque, la charpente penche légèrement, se redresse, bouge encore, couine, comme si elle se tordait de douleurs. Véronique suit le nain. Un escalier en colimaçon les conduit vers une cave immense. Tout un mur est occupé par un alignement, sur plusieurs étages, de bocaux géants où surnagent des bouts de corps, des bras, des jambes, des têtes, des troncs. Indolents, ils semblent flotter doucement dans le récipient. Chacun d’eux est étiqueté. Juif. Tzigane. Russe. Polonais. Epileptique. Commissaire… Le jeu consiste à briser, à l’aide d’une boule de fer, un récipient qui explose dans un jaillissement de verre brisé, un éclaboussement de liquide, un tonnerre d’applaudissements pré-enregistrés. Le gagnant hérite du quartier de corps ainsi libéré. « Bravo, Madame ! » hurle soudain l’animateur. Il s’approche de la journaliste, en exhibant sans vergogne un bras sectionné. « Toutes nos félicitations ! ». Véronique pourtant n’a pas eu l’impression d’avoir joué ; elle refuse le « cadeau » ; mais elle sent une main la saisir ; elle crie, elle se réveille.
C’est Boreli qui la secoue
Elle est allongée sur une table du restaurant. Son crâne n’en finit pas d’imploser.
« Quelle…quelle heure est-il ? Demande-t-elle, hébétée.
– Minuit, un peu plus peut-être.
– Tu… tu as vu Serge ?
– Non.
Le flic semble désolé, il dit avoir été retardé. Elle ne comprend pas bien ce qu’il raconte. Il aurait conduit Federmann-Dutriez chez des amis à Sarreguemines ; de là-bas, il aurait téléphoné au café mais personne n’aurait répondu. A son retour, tout à l’heure, il a trouvé la jeune femme sans connaissance en bas de l’escalier.
Véronique l’écoute à peine, elle redemande :
– Tu as vu Serge ?
– Tu te répètes.
– Il était dans sa chambre.
Elle crie :
– Va voir !
– D’abord, je m’occupe de toi !
Elle hurle :
– Non, merde, va voir !
– Quoi ?
– Dans sa chambre !
Impressionné, le flic grimpe à l’étage. Elle crie encore :
– Prend le texte !
– Quel texte ?
– Sur son lit !
Il revient illico. Il n’a vu personne, et il n’y a pas de texte dans la chambre.
– Il faut trouver Serge !
– Laisse-moi te soigner, non ? Qu’est-ce qui s’est passé ici ?
Véronique a l’impression qu’on lui a arraché une partie de la tête ; ses nerfs sont comme des cordes tendues qu’un cinglé serait en train de gratter pour les faire vibrer.
Cesare sort tout un attirail, de la glace, des calmants ; cela ne l’apaise guère.
Elle veut surtout lui raconter sa découverte, s’embrouille, s’énerve, pleure ; il la calme, l’oblige à se taire. Ça cogne toujours dans sa tête comme les coups sourds d’un démolisseur. Défaite, elle accepte les soins, rumine son histoire puis, lentement, d’une voix hachée, déroule le récit. Il tente de l’interrompre :
– Ça peut pas attendre, non ?
– Non !
Elle parle d’une voix de basse qu’elle ne se connaît pas, comme si elle avait mué. Tout défile : le document sur le lit, Hirt, le Struthof, les expériences, le principe de la collection, la réponse de Himmler, Auschwitz, les 87, la chambre à gaz, les caves de l’Institut et surtout, surtout, la venue de Serge, l’itinéraire de Serge, la fuite de Serge, le « Monde Diplo », la vengeance de Serge…
Boreli fait craquer ses articulations ; son visage se plisse comme s’il était traversé par une nuée d’oiseaux.
– C’est lui, ton tueur de mandarins !
– Qui ?
– Serge !
– ... J’avais rien senti.
– T’avais rien senti…ou t’avais rien voulu sentir ?
– Pourquoi tu dis ça ?
– Pour rien. Comme ça.
– ?!
Choqué, il se lève, sort ; Véronique, péniblement, le suit ; elle marche à pas comptés. Il l’interpelle :
– Parce que t’avais vu quelque chose, toi ?
Elle hausse les épaules. La nuit est noire. Du brouillard persiste.
Le calme n’est qu’apparent. On entend un lointain bruit de moteur. D’instinct, ils se dirigent, lentement, presque craintivement, vers le terrain de foot. Le froid revigore la jeune femme.
Les lumières d’un gyrophare percent peu à peu des filets de brume, du côté du club sportif. Ils hâtent le pas. La horde de motos qui, la veille, envahissait la pelouse semble être partie. Restent ici et là des tentes, à demi renversées. Sur le terrain de foot, des gendarmes s’activent autour d’un drap blanc qui masque une forme, étrange, comme s’il recouvrait un nain.
Véronique repense au nabot de son rêve.
Le flic aborde le militaire, se présente. Ce dernier lui raconte la nuit. Lui et son collègue se relayaient, l’un faisait le gué pendant que l’autre somnolait. De la salle s’échappait une rumeur épaisse et ininterrompue. De temps à autre, un des participants sortait pisser en éructant. La porte entrouverte laissait alors passer des chants, des cris, un vacarme assourdissant. Puis la brute regagnait la meute et « tout était à nouveau sous contrôle ». Soudain, il n’était pas encore minuit, tout est allé très vite. Une forme s’est dressée sur le stade et s’est mise à hurler, en allemand. Le gendarme a d’abord cru que c’était un des motards. L’homme demeurait dans la pénombre, il était difficile à identifier. Mais l’autre invectivait les nazis, les défiait, jetant des projectiles sur le club. Il a fini par briser une vitre. Des types sont sortis du bâtiment. L’homme a redoublé ses insultes. Quelqu’un a crié : « Un antifa ! ». Alors, ce fut la curée. Les motards avinés se sont mis à castagner l’imprécateur. Ils furent bientôt dix, vingt sur lui, une foule déchaînée, qui le martelèrent à coups de pieds. Un type, qui devait être leur chef, cria à la provocation, tenta de calmer les siens mais c’était trop tard. Il était débordé.
« On est accouru, mon collègue et moi mais, le temps d’arriver, on ne pouvait plus faire grand chose. La meute avait piétiné l’homme. Bernard, il désigne l’autre gendarme, est allé appeler des renforts, et moi je me suis efforcé de faire obstacle comme je pouvais. J’ai dégainé, menacé. J’ai même dû tirer une sommation en l’air. C’était la pagaille générale, les motards se sont sauvés en catastrophe. J’ai juste pu retenir une nana qui n’arrivait pas à faire partir son engin ».
La fille-insecte, qui était venue au café la veille en fin de matinée, est effondrée au pied du local, menottée à sa moto.
« On devrait, avec elle, pouvoir remonter la filière ».
Véronique, elle, écoute à peine, médusée par le fantôme qui hante le terrain de foot.
Le club est dévasté, ses parois maculées d’inscriptions nazis, de croix gammées, de slogans peinturlurés : « White power », « AlSSace » avec deux S majuscules et obscènes, « L’Alsace dans le Reich ! L’Alsace est allemande depuis mille ans ! » ou encore « Les immigrés sont des lapins ! »
Un DVD continue de tourner en boucle sur une petite télé, près de la tribune. Il parle de « l’holocauste », celui qu’auraient commis les Alliés en bombardant les villes allemandes ; de l’opération Gomorrah, l’été 1943, sur la ville de Hambourg.... Un aigle noir en bois de deux mètres gît dans un coin de la salle.
La journaliste s’est insensiblement approchée du spectre. Le gendarme soulève le drap.
« C’est bien votre ami ? »
Véronique serre les poings, les porte à sa bouche. Une sorte de rugissement s’étrangle dans sa gorge. Cesare, lui, se désarticule les phalanges. C’est à peine s’ils reconnaissent le visage de l’ange blond. Sa face bleuie est littéralement disloquée, son costume de lin est noirci de sang, déchiré. L’humanitaire est à genoux, les fesses sur les talons, bras tendus de part et d’autre, les mains au sol. Tout en mourant, Serge s’est redressé et son corps garde cette position d’ultime défi.
14
STRASBOURG, été 1945
Arc en ciel
« Mon commandant, je rêvais d’être un traqueur de nazis. Et je l’ai été finalement, six mois, ces six derniers mois ; mais je crois bien que cette première enquête sera la dernière. J’ai mené à bien mon travail, mais franchement, je ne suis pas fait pour ça. Je rends mon uniforme, je rentre dans mes foyers. Dans mon atelier plus exactement. Ce n’est pas des gens comme moi qu’il faut pour chasser le mal. Je retourne à la peinture.
A l’heure où je termine ce journal, je vois par la fenêtre du bureau, sur un ciel bleu-noir, parader un somptueux arc en ciel. Un signe ?
Capitaine Adam Meerepol
Service de recherche des criminels de guerre.
15
Dimanche 15 mai
9h30
Cesare et Véronique rejoignent dans la matinée Strasbourg, derrière l’ambulance qui transporte Serge à la morgue. Le capitaine a fouillé « Jérusalem ». Il n’a trouvé aucune trace du rapport.
Son portable sonne. C’est Noël, son assistant. Boreli ne lui laisse pas le temps d’en placer une, lui dit que Kougelman a été assistant-préparateur à l’Institut d’anatomie de Strasbourg durant l’annexion allemande. Comme Birdof. Comme Birmann. Comme Hauser.
« C’est bien ça ? »
L’autre le prend mal, se met en colère :
« C’était bien la peine de me demander de passer le week-end sur le dossier si t’étais au courant ! »
Furieux, il raccroche. Boreli hausse les épaules, ne dit rien. Véronique regarde le ciel ; il est miraculeusement dégagé, clair, lavé. Elle esquisse un sourire triste :
« Je pense à ce qu’avait dit le kurde, devant l’appartement de Kougelman… Ou encore les vieux de la maison de retraite. Et même Birdof dans son délire. Ils parlaient tous d’un homme en blanc, avec un casque blanc, précise même le kurde. Tu te souviens ? Ils voulaient sans doute parler du costar crème, et du panama, de Serge, non ?
– De toute façon, tout ça n’a plus d’importance, répond le flic.
– Pourquoi ?
– Ce que je veux dire….
– Oui ?
– C’est que je ne vais pas parler de l’histoire de Serge.
– T’es sûr ?
– Ni du rapport ; d’abord, il y a pas de rapport.
– T’as pas le droit !
– C’est comme ça. J’ai décidé.
– Et si je parle, moi ?
– Tu ne parleras pas, je le sais !
– Et pourquoi ?
– On ne saura rien d’Aigle, du passé de Serge Aigle. A quoi bon le salir ?
– Mais alors ? L’enquête ?
– Si tu avais lu mon manuel, tu saurais qu’une enquête sur trois n’aboutit jamais.
Les paysages d’Alsace-Moselle évoqués ici sont largement imaginaires ; il serait vain de chercher des repères géographiques précis.
L’histoire des 86 est avérée. Les personnages d’Ernest Kougelman, Rolf Birdof, Walter Birmann et Julius Hauser sont inventés.
ANNEXES
Les noms des chiffres
Au terme d’une minutieuse enquête menée par l’historien allemand Hans-Joachim Lang, l’identité des 86 juifs massacrées, début août 1943, au Struthof, a pu être établie en…2003. Il s’agit de :
Akouni David
Alaluf Bella
Albert Israel
Amar Elvira
Amar Emma
Arnades Palomba
Aron Aron
Aruch Nety
Ascher Martin
Asser Esra
Attas Allegra
Baruch Ernestine
Basch Joachim
Behrendt Joachim
Benjamin Günther
Beracha Allegre
Bezsmiertny Kalman
Bluosilio Samuel
Bober Harri
Bomberg Sara
Boroschek Sophie
Buchar Nisin
Cambeli Rebeca
Cambeli Sarica
Cohen Elei
Cohen Juli
Cohn Hugo
Dannenberg Günter
Dekalo Sabi
Driesen Kurt
Esformes Aron
Eskaloni Aron
Eskenazy Ester
Francese Maurice
Franco Abraham
Frischler Heinz
Geger Benjamin
Gichman Fajsch
Grub Brandel
Haarzopf Hugo
Hassan Charles
Hayum Alfred
Herrmann Rudolf
Herschfeld Jacob
Isaak Albert
Isak Israel
Kapon Sabetaij
Kempner Maria
Khan Levei
Klein Elisabeth
Kotz Jean
Krotoschiner Paul
Leibholz Else
Levi Kurt
Litchi Ichay
Marcus Michael
Matalon Maria
Matarasso Abraham
Menache Lasas
Mosche Katerina
Nachman Regina
Nachmias Siniora
Nathan Dario
Nissim Sarina
Osepowitz Heinrich
Passmann Jeanette
Pinkus Hermann
Polak Jacob
Rafael Israel
Rafael Samuel
Rosenthal Siegbert
Sachnowitz Frank
Sainderichin Marie
Saltiel Albert
Saltiel Maurice
Saporta Maurice
Saul Mordochai
Seelig Gustav
Simon Alice
Sondheim Emil
Steinberg Sigurd
Sustiel Nina
Taffel Menachem
Testa Martha
Urstein Maria
Wollinski Walter
Une plaque commémorative avec ces noms a été apposée dans le bâtiment abritant la chambre à gaz au Struthof au printemps 2005.
« Longtemps, ici, le silence a prévalu. On a même tenté d’oublier : le malheur est si grand, les motssi faibles pour le dire », dira le président Jacques Chirac.
Une autre plaque, évoquant ce même crime, a été inaugurée à l’Institut d’Anatomie de l’Université de Strasbourg en décembre 2005. A une centaine de mètres de cet Institut se trouve depuis bien longtemps un autre bâtiment universitaire baptisé « Pavillon Leriche ». René Leriche a été Premier président du Conseil supérieur de l’Ordre des médecins sous Vichy.
Le 12 mai 2011 a été officiellement inauguré à Strasbourg le quai Menachem Teffel, avec cette inscription : « Menachem Teffel, 1900, Sedriczow-Pologne, 1943, Struthof, victime des expérimentations médicales nazies ».
L’action menée par le cercle Menahem Taffel, association constituée en 1992 autour du psychiatre Georges Federmann, a été décisive pour la reconnaissance du crime.
Bibliographie sommaire
Bernadac, Christian, Les médecins maudits, France empire, 1967.
Chollet, Laurent, L’insurrection situationniste, Dagorno, 2000.
Federmann, George Y., « Le cercle Menachem Taffel », en ligne sur le site web Judaïsme d’Alsace et de Lorraine.
— - « L’horreur de la médecine nazie. Struthof, 1943. Qui se souviendra de Menachem Taffel ? », Quasimodo n°9 , pp 109-126.
Huntziger Robin, Struthof, un souvenir français, 2005, film documentaire FR3/Alsace.
Klee, Ernst, La médecine nazie et ses victimes, Solin, 1999.
Kogon, Eugen, Hermann Langbein et Adalbert Rueckerl, Les chambres à gaz, secret d’Etat, éditions de Minuit, 1984.
Lang, Hans-Joachim, Die namen der nummern , Hoffmann et Campe, 2004.
Le Minor, Jean-Marie, Les sciences morphologiques médicales à Strasbourg du 15e au 20e siècle, PUF, 2002
Mager, Claude, « Partout, autour de moi, des rafles », Le Monde diplomatique, courrier des lecteurs, août 1993, p2
Schirer, William, Le troisième Reich, des origines à la chute, Stock, 1961.
Steegmann, Robert, Struthof, La Nuée Bleue, 2005.
Wechsler, Patrick, « La faculté de médecine de la Reichsuniversitat Strassburg (1941-1945) à l’heure nationale socialiste », thèse de doctorat de médecine, Strasbourg, 1991.